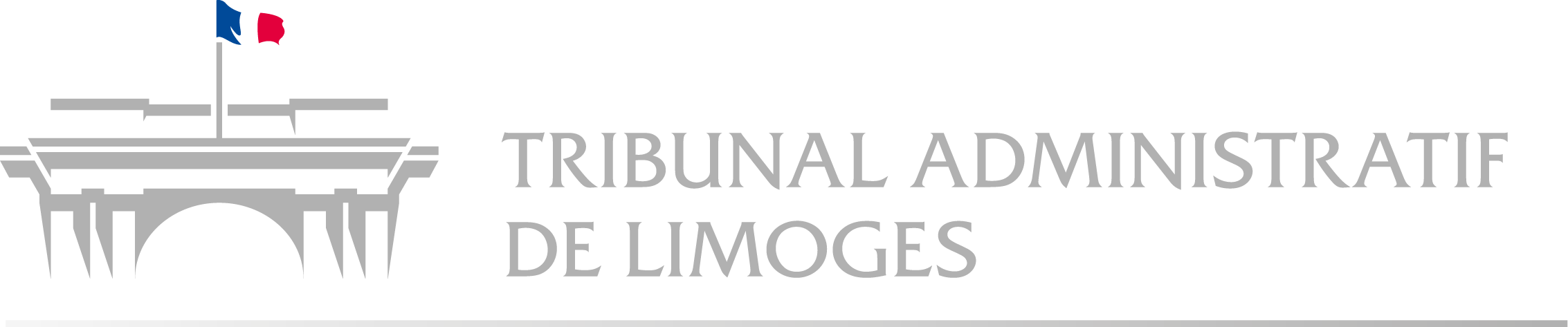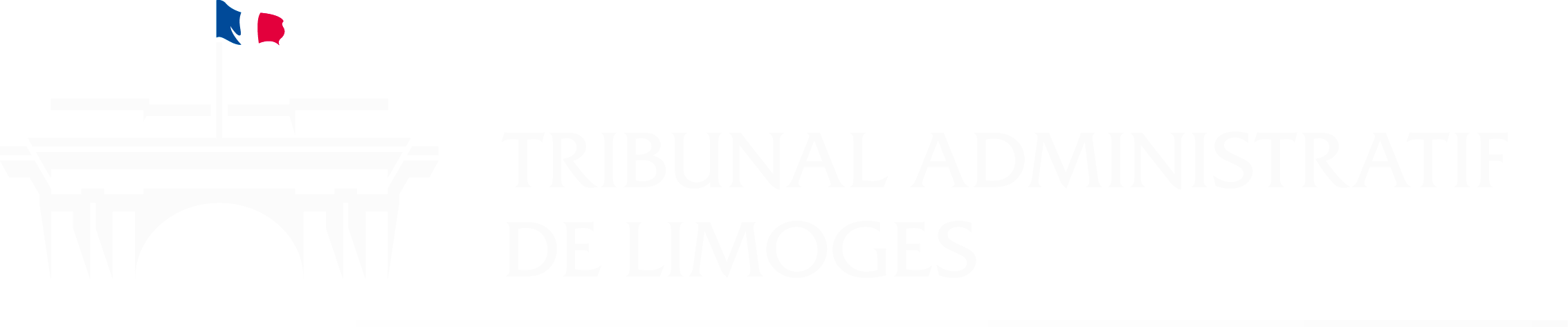Accédez à l'analyse des principaux jugements rendus par le tribunal administratif.
Tribunal administratif de Limoges, 11 juillet 2019, n° 1800614
Tribunal administratif de Limoges, 18 novembre 2019, n° 1700079
Tribunal administratif de Limoges, 12 décembre 2019, n° 1700754
Tribunal administratif de Limoges,26 avril 2018, n° 151145
Tribunal administratif de Limoges, 31 octobre 2018, n° 16994
Tribunal administratif de Limoges, 31 mai 2018, n° 16325
Jurisprudence du 1er mai au 31 décembre 2018
Droits civils et individuels – Droit de propriété.
. Tribunal administratif de Limoges, 31 octobre 2018, M. et Mme Lemesle, n° 1601381, C+
Président : M. Gensac.
Rapporteure : Mme Namer.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a considéré que la juridiction administrative était incompétente pour connaitre des conclusions tendant à la reconnaissance d’une emprise irrégulière, à l’indemnisation de ses conséquences dommageables et à ce qu’il y soit mis fin.
Par l’arrêt de principe du 9 décembre 2013, n° 3931, le Tribunal des conflits a largement réduit le champ d’application de la notion d’emprise irrégulière, laquelle entraine la compétence exclusive des juridictions judiciaires. La compétence des juridictions administratives n’est plus écartée qu’en cas d’extinction du droit de propriété.
Le tribunal a considéré qu’en l’espèce, les requérants ont été dépossédés du droit réel immobilier qu’ils détenaient sur une concession funéraire d’un cimetière communal, dès lors que la même concession avait été également concédée à d’autres personnes. Il s’agit là, selon le tribunal, d’un cas d’extinction d’un élément du droit de propriété, dont les conclusions, tendant à sa reconnaissance, son indemnisation et tendant à ce qu’il y soit mis fin, relèvent exclusivement de la compétence d’une juridiction judiciaire.
Fonctionnaires et agents publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 31 mai 2018, Confédération française des travailleurs chrétiens syndicat libre justice, n° 1600325, C+.
Présidente : Mme Carthé Mazères.
Rapporteure : Mme Namer.
Rapporteur public : M. Houssais.
Le tribunal a jugé que les autorisations d'absences prévues par l'article 15 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique pouvaient être refusées en raison des nécessités du service.
Ces autorisations d'absence sont prévues afin que les fonctionnaires représentants syndicaux siègent au sein de certains instances, notamment au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux ou encore des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’article 13 du décret relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, qui prévoit un autre type d’autorisations d’absence, permettant aux représentants des organisations syndicales d’assister aux congrès syndicaux et aux réunions de leurs organismes directeurs, prévoit expressément que ces autorisations d’absence sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Si l’article 15 du même décret ne prévoit pas expressément la même réserve, le tribunal a considéré que cette réserve s’appliquait tout de même également aux autorisations d’absence demandées sur le fondement de l’article 15.
. Tribunal administratif de Limoges, 21 novembre 2018, Mme …., n° 1801634, C+.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : M. Boschet.
Rapporteur public : M. Houssais.
Adjoint administratif principal affectée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Corrèze, la requérante, qui avait passé avec succès les épreuves écrites d’admissibilité de l’examen professionnel ouvert pour l’accès au grade de secrétaire administratif de classe normale relevant des ministères chargés des affaires sociales, demandait l’annulation de la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé avait refusé de l’admettre à se présenter aux épreuves orales d’admission de cet examen professionnel au motif qu’elle n’était « ni gérée ni payée par les ministères sociaux ».
Selon le 2° de l’article 2 du décret n° 2012-483 du 13 avril 2012, l’examen professionnel, auquel s’était présentée l’intéressée, est ouvert aux adjoints administratifs « relevant des ministres chargés des affaires sociales ou affectés dans les services relevant de ces ministres » et justifiant d’une certaine ancienneté de services publics.
Le tribunal a, d’abord, relevé que la requérante, affectée depuis le 1er janvier 2010 au sein de l’unité « solidarité et insertion sociale » du pôle cohésion sociale de la DDCSPP de la Corrèze, faisait valoir, sans être contredite, que le service dans lequel elle était affectée recevait des instructions de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) qui est placée, notamment, sous l’autorité de la ministre des solidarités et de la santé. Il a, ensuite, précisé que le périmètre des compétences de la DDCSPP recoupe, en partie, celui de la DGCS, en particulier pour ce qui concerne la prise en charge des personnes handicapées, leur insertion sociale et les prestations et allocations dont ces personnes bénéficient. En outre, la formation collégiale a indiqué qu’il ressortait de la fiche de poste de la requérante que celle-ci avait pour missions, au titre de ses « activités principales », de suivre le pilotage de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de participer à des commissions des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et aux équipes pluridisciplinaires de la mission départementale des personnes handicapées (MDPH) et, enfin, d’enregistrer les dossiers de demande d’agrément « vacances adaptées organisées » (VAO) et de contribuer aux contrôles des organismes qui se sont vus délivrer cet agrément. Le tribunal a noté que l’entête de cette fiche de poste faisait expressément mention des ministères chargés des affaires sociales.
Dans ces conditions, le tribunal a jugé que l’intéressée devait être regardée comme étant affectée depuis le 1er janvier 2010 au sein d’un service relevant des ministères chargés des affaires sociales au sens du 2° de l’article 2 du décret n° 2012-483 du 13 avril 2012. La seule circonstance que sa paie était supportée budgétairement par le ministère de la transition écologique et solidaire et qu’elle était affectée dans une direction départementale interministérielle placée sous l’autorité du préfet de département est sans incidence, d’autant qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet est le représentant de chacun des ministres et, ainsi, des ministres chargés des affaires sociales. Le tribunal en a déduit que la décision attaquée était entachée d’une erreur d’appréciation et en a prononcé l’annulation pour ce motif.
Les épreuves orales se déroulant quelques jours après la date de lecture de son jugement, le tribunal a, par ailleurs, enjoint à la ministre des solidarités et de la santé d’admettre la requérante à se présenter aux épreuves d’admission de l’examen professionnel en cause.
. Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2018, M. …., n° 1601031, C+.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : M. Boschet.
Rapporteur public : M. Debrion.
Un fonctionnaire, relevant de la fonction publique de l’Etat, a été détaché auprès d’un conseil départemental pour une période de deux ans allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012. Ce détachement a été renouvelé du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. Peu de temps avant l’arrivée à son terme de ce détachement, le département a proposé à l’agent son intégration dans le cadre d’emplois d’accueil. Après que l’intéressé a refusé cette proposition, son détachement a de nouveau été renouvelé pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. A l’approche de la fin de cette nouvelle période de détachement, l’agent a finalement demandé son intégration dans la fonction publique territoriale en application de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par un arrêté du 27 mai 2016 et une décision du 9 juin 2016, le président du conseil départemental a refusé de renouveler le détachement de l’agent à son terme, le 30 juin 2016, et rejeté la demande d’intégration formulée par l’intéressé. Ce dernier a demandé au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, en ce qui concerne la décision du 9 juin 2016, le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, selon lesquelles : « Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois ».
Ensuite, il a relevé que le requérant avait été détaché auprès de la collectivité locale de manière continue du 1er juillet 2010 au 30 juin 2016, soit pendant une période supérieure à celle de cinq ans mentionnée au dernier alinéa de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et, qu’en application de ces dispositions, le département était tenu de lui proposer une intégration dans la fonction publique territoriale. Le tribunal a jugé que si, à l’approche de la fin de la deuxième période de détachement, le département avait proposé au requérant une intégration dans le cadre d’emplois d’accueil, cette seule proposition, qui était facultative, et qui avait été faite alors que l’intéressé n’était pas encore « admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans » au sens du dernier alinéa de l’article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, n’était pas suffisante pour exonérer l’administration de son obligation de proposer une intégration à l’expiration d’une période de cinq ans de détachement. Le tribunal a donc annulé la décision du 9 juin 2016.
En second lieu, en ce qui concerne l’arrêté du 27 mai 2016, le tribunal a considéré que le requérant ne pouvait pas utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision du 9 juin 2016, laquelle était, en tout état de cause postérieure.
En outre, la formation collégiale a estimé qu’en se bornant à affirmer, sans apporter les précisions utiles, d’une part, qu’il avait donné satisfaction pendant la durée de son détachement et, d’autre part, qu’il avait été promu au 7ème échelon du grade dans lequel il avait été détaché, le requérant n’établissait pas que la décision par laquelle le président du conseil départemental avait refusé de renouveler son détachement à son terme était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’autant que le département faisait valoir, sans être contredit, que la promotion du requérant au 7ème échelon de son grade résultait d’un avancement automatique. Le tribunal a ainsi rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant refus de renouvellement du détachement.
Nature et environnement.
. Tribunal administratif de Limoges, 31 octobre 2018, Association Lumière sur les pratiques d’élevage et d’abattage, n° 1600994, C+.
. Tribunal administratif de Limoges, 31 octobre 2018, Traditions Terroirs et Ruralité, n° 1600812, C
Président : M. Gensac.
Rapporteure : Mme Namer.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a rejeté deux recours formés par des associations contre des décisions du préfet de la Creuse refusant de constater la caducité d’une autorisation d’exploiter un élevage de bovins à l’engraissement de 1 000 places à Saint-Martial-le-Vieux, au motif que ces associations n’avaient pas d’intérêt à agir contre les décisions litigieuses. Il a fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui exige, pour conférer à une association un intérêt pour contester une décision devant le juge administratif, en plus d’un objet social adapté, une correspondance entre le champ géographique de l’association et la décision attaquée (CE, 1989, n° 83153 ; CE, 1994, n° 139125 ; CE, 1996, n° 155477).
Il était indiqué dans l’objet social de la première de ces associations que ses actions « s’inscrivent au niveau local, national et international ». Le tribunal a considéré qu’au vu de l’imprécision de cette définition de son champ d’action géographique, et au vu des autres articles de ses statuts, l’association ne pouvait être regardée comme ayant un champ géographique circonscrit à une localité.
La seconde association ne définissait pas, dans ses statuts, son champ géographique. Le tribunal a considéré, et eu égard à l’ensemble des stipulations de ses statuts, que ce champ ne pouvait être regardé, là encore, comme étant circonscrit à une localité.
Le tribunal ayant considéré que la décision attaquée, relative à un projet d’exploitation d’un élevage de bovins à l’engraissement implanté sur le territoire de la commune de Saint-Martial-le-Vieux, ne concernait, tout au plus, qu’un périmètre n’excédant pas le département de la Creuse, les associations n’étaient pas recevables à agir.
. Tribunal administratif de Limoges, 29 novembre 2018, Fédération Tempête en Marche, n° 1601558, C+
Président : M. Gensac.
Rapporteure : Mme Namer.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a jugé que le délai de distance, prévu par les dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative, pour les personnes demeurant à l’étranger et introduisant un recours devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, ne pouvait s’ajouter au délai de quatre mois, prévu par l’article L. 514-6 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date d’introduction de la requête, pour la contestation des décisions concernant les installations de production d'énergie d'origine renouvelable. En effet, l’article R. 421-7 du code de justice administrative prévoit l'application des délais supplémentaires de distance uniquement dans le cas du délai de deux mois figurant à l'article R. 421-1 du même code. Aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'institution de délais de distance, lesquels ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant une juridiction administrative, aux demandes de première instance dirigées contre les décisions d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement.
En revanche, le tribunal a considéré que le délai de recours formé par des tiers contre une décision d’autorisation d’exploiter un parc éolien était prorogé par l’exercice d’un recours administratif. Si une telle prorogation du délai de recours est exclue pour les recours des demandeurs ou exploitants dirigés contre les décisions de refus d’exploiter (CE, 1993, n° 122012 ; CE, 1998, n° 182816), une telle exclusion s’explique par leur rôle particulier au cours de l’instruction de la demande, et ne saurait donc être appliquée aux tiers.
. Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2018, Mme …. et autres, n° 1700249, C
Président : M. Gensac.
Rapporteure : Mme Namer.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Association France nature environnement (CE, 2017, n° 400559) et a considéré que l’avis de l’autorité environnementale émis dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter un parc de cinq éoliennes par le préfet de la région Limousin était irrégulier dès lors que le préfet de région, également préfet du département de la Haute-Vienne, était compétent pour autoriser le projet. Ainsi, alors que la compétence consultative en matière environnementale n’a pas été exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard de l’autorité devant statuer sur la demande d’autorisation d’exploiter, les conditions dans lesquelles a été recueilli l’avis de l’autorité environnementale n’étaient pas régulières. La circonstance qu’au cours de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter, le préfet de la Haute-Vienne a perdu la qualité de préfet de région, en application de la loi du 16 janvier 2015, ne permet pas d’établir que la compétence consultative en matière environnementale a été exercée par une entité interne disposant d’une autonomie réelle, alors que le préfet de la Haute-Vienne était également préfet de la région Limousin à la date de l’avis de l’autorité environnementale.
Un tel vice peut toutefois être régularisé en application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, comme l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 2018, n° 420119). A titre de régularisation, le tribunal a laissé au préfet de la Haute-Vienne un délai de huit mois afin de procéder à la consultation de la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. L’avis rendu par cette autorité sur le projet de parc éolien devra être porté à la connaissance du public, soit dans le cadre d’une enquête publique complémentaire, soit par sa publication sur internet. Le préfet devra ensuite se prononcer une nouvelle fois sur la demande d’autorisation d’exploiter le parc éolien.
Responsabilité de la puissance publique.
. Tribunal administratif de Limoges, 4 décembre 2018, M.et Mme …., n° 1600841.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : M. Boschet.
Rapporteur public : M. Houssais.
Après un avis défavorable à l’indemnisation émis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (Crci), les parents d’un enfant né avec une anophtalmie bilatérale non décelée pendant la grossesse demandaient la condamnation du centre hospitalier à la réparation de divers préjudices. Ils soutenaient que le gynécologue-obstétricien de ce centre hospitalier, qui avait réalisé les échographies de contrôle des deuxième et troisième trimestres de la grossesse, avait commis une faute dans le diagnostic prénatal de leur enfant.
Le tribunal a d’abord rappelé les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, aux termes desquelles : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. (…) / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice ».
Après avoir écarté l’argumentation des requérants quant à un éventuel manque de qualification du praticien hospitalier ayant réalisé les échographies prénatales, le tribunal a ensuite relevé que si ce médecin spécialiste avait omis de prendre quatre clichés recommandés par le comité national technique d’échographie de dépistage (CNTE) dans son rapport d’avril 2015, à savoir les clichés de la coupe des reins, de la coupe nez-bouche et de la coupe des gros vaisseaux du cœur, il ressortait toutefois de l’avis de la Crci, qui n’était pas contesté sur ce point, que ces clichés manquants n’auraient pas permis de déceler l’anomalie rare présentée par le fœtus.
Enfin, se fondant sur une décision n° 397722 du 25 octobre 2017 du Conseil d’Etat, le tribunal a indiqué que si la vérification des orbites et des cristallins est une pratique habituelle chez certains médecins au cours des échographies prénatales, cette vérification, qui ne figure pas sur la liste des recommandations faites par le CNTE, n’est pas une obligation professionnelle. La formation collégiale a jugé qu’en l’état des données de la science, cette vérification constitue uniquement une bonne pratique médicale dont la méconnaissance ne révèle pas une faute caractérisée au sens de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles. En l’absence d’une telle faute caractérisée, le tribunal a rejeté la requête.
Jurisprudence du 1er janvier au 30 avril 2018
Environnement
. Tribunal administratif de Limoges, 1er mars 2018, Mmes…, n° 1501799, C.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : Mme Namer.
Rapporteur public : M. Debrion.
Dans cette affaire, le Tribunal a eu l'occasion de faire une application particulière de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 14 octobre 2011, Société Ocréal (n° 323257, B).
Les requérantes demandaient l'annulation d'un arrêté préfectoral d'enregistrement, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, d'un projet d'agrandissement conséquent d'un élevage de porcs. Elles soulevaient notamment un moyen tiré de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique. Elles estimaient ainsi que les mentions relatives aux capacités financières de l'exploitant dans le dossier de demande d'enregistrement, composante du dossier d'enquête publique, étaient trop succinctes.
Le Tribunal, après avoir estimé que la justification des capacités financières de l'exploitant étant incomplète, a néanmoins neutralisé ce vice de procédure. Il a estimé que l'insuffisance n'avait pas nui à l'information complète de la population dans les circonstances particulières de l'espèce. En effet, une précédente enquête publique avait été réalisée sur le même projet porté par le même exploitant en 2010. Il a donc considéré que les informations cumulées mises à la disposition du public dans le cadre de ces deux enquêtes publiques pouvaient être considérées comme suffisantes. Le Tribunal a également estimé que l'insuffisance de l'exposé des capacités financières de l'exploitant de la porcherie n'avait pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité préfectorale, laquelle avait reçu des documents complémentaires de la part de l'exploitant.
Marchés publics
. Tribunal administratif de Limoges, 26 avril 2018, Conseil régional de l’ordre des architectes, n° 1501145.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : M. Houssais.
La communauté de communes Ecueillé-Valençay (Indre) a engagé, en mars 2015, une procédure adaptée en vue de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux d’aménagement d’un atelier de découpe et de transformation des viandes et d’adaptation de l’abattoir communautaire de Valençay.
Le tribunal administratif était saisi d’un recours en contestation de validité de ce marché public de maîtrise d’œuvre, exercé par le conseil régional de l’ordre des architectes du Centre-Val-de-Loire sur le fondement de la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne du Conseil d’Etat (4 avril 2014, n° 358994, en A), selon laquelle tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de cet acte ou de certaines de ses clauses.
Dans un premier temps, le tribunal a écarté une exception à fin de non-lieu à statuer et plusieurs fins de non-recevoir soulevées en défense, tirées de l’absence de signature du contrat litigieux, dans la mesure où il résultait de l’instruction que celui-ci avait été signé en septembre 2016, soit en cours d’instance.
La formation collégiale a également eu à connaître d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du conseil régional de l’ordre des architectes.
Sur ce point, le tribunal a tout d’abord rappelé qu’eu égard à sa qualité de tiers au contrat, il appartenait à l’ordre professionnel d’établir l’existence d’irrégularités ayant lésé de façon suffisamment directe et certaines les intérêts collectifs des membres de la profession d’architecte.
A cet égard, le conseil régional de l’ordre des architectes du Centre-Val-de-Loire reprochait au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir prévu le versement d’une prime aux candidats ayant présenté une offre, méconnaissant ainsi l’article 74 du code des marchés publics, alors applicable, dans la mesure où les documents de la consultation prévoyaient le dépôt de « prestations ».
Ce faisant, analysant le règlement de la consultation, le tribunal a jugé qu’en demandant aux candidats la remise d’un mémoire technique comportant, notamment, la proposition d’un parti constructif et l’aspect architectural du bâtiment, la communauté de communes a entendu solliciter la remise d’une intention architecturale devant être regardée comme une prestation au sens des dispositions de l’article 74 du code des marchés publics.
Partant, il a été jugé qu’en ne prévoyant pas la rétribution des candidats, le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement restreint l’accès au marché litigieux et, de ce fait, affecté les modalités d’exercice de la profession d’architecte. C’est ainsi que la formation de jugement a, tout à la fois, admis l’intérêt à agir de l’ordre des architectes et retenu que l’administration avait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient.
Toutefois, faisant application du pouvoir d’appréciation dont dispose le juge du contrat face à une telle irrégularité, le tribunal a décidé de rejeter les conclusions en annulation présentées par le conseil régional de l’ordre des architectes du Centre-Val-de-Loire.
Il a en effet été pris en compte que l’absence de versement d’une prime aux candidats au marché de maîtrise d’œuvre ne frappait pas le contrat d’illicéité, n’a pas affecté le consentement des parties et, dans les circonstances de l’espèce, ne pouvait être analysée comme un vice d’une particulière gravité. Sur ce point, le tribunal a notamment pris en compte l’objet du marché et la circonstance qu’il n’était pas établi que certaines entreprises aient effectivement renoncé à soumissionner du fait de l’absence de rétribution.
. Tribunal administratif de Limoges, 26 avril 2018, Compagnie Allianz Iard, n° 1501581.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : Mme Béria-Guillaumie.
Rapporteur public : M. Houssais.
Le département de l'Indre, dans le cadre d’un marché de construction de pylônes destinés à recevoir les antennes de télécommunication des opérateurs de téléphonie mobile, avait confié à la société CEGELEC le lot portant sur la fourniture de la charpente métallique. Un peu plus d’un an après la réception des travaux, des dommages, résultant de la rupture de certains boulons des pylônes, ont été constatés. La société CEGELEC, titulaire du marché, a assuré le remplacement de l’ensemble des boulons de quatre pylônes en cause. Elle a déclaré le sinistre à son assureur, la Compagnie Allianz Iard, et avait été indemnisée par ce dernier.
Le Tribunal de Limoges était saisi par la Compagnie Allianz Iard d’une requête tendant à la condamnation du Bureau Véritas, qui s’était vu confier, dans le marché public en cause, la mission de maître d’œuvre. Les conclusions de la société requérante était exclusivement fondée sur l’engagement de la responsabilité décennale de la société Bureau Véritas, constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de l’assureur du constructeur en soulignant que l’action en responsabilité décennale n’appartenait en principe qu’au maitre de l’ouvrage ou à son assureur subrogé dans ses droits. Le Tribunal a rappelé que la société requérante se prévalait uniquement de sa subrogation dans les droits d’un des constructeurs du marché et que cette seule qualité, en l’absence de subrogation dans les droits du département, bénéficiaire de l’action en responsabilité décennale, ne pouvait pas lui permettre d’exercer l’action en responsabilité décennale à l’encontre d’un autre constructeur.
Jurisprudence du 1er septembre au 31 décembre 2017.
Enseignement et recherche.
. Tribunal administratif de Limoges, 7 décembre 2017, M. D…., n° 1601593.
Président : M. Iselin.
Rapporteure : Mme Béria-Guillaumie.
Rapporteur public : M. Houssais.
Le Tribunal était saisi par un étudiant qui, ayant validé une première année de master en droit auprès de l’Université de Limoges, avait été admis à s’inscrire en deuxième année de ce master, au cours de l’année universitaire 2015-2016. N’ayant pas obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur vingt, il n’avait pas été autorisé à s’inscrire, une nouvelle fois, en deuxième année de master de droit au cours de l’année universitaire 2016-2017. Cet étudiant contestait, devant le Tribunal administratif de Limoges, le refus de redoublement qui lui avait été opposé par l’Université de Limoges.
Dans un avis du 10 février 2016, n° 394594 et 394595, classé en A, le Conseil d’Etat avait précisé qu’il résultait des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l’éducation que l’admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu’elles mentionnent. Le Conseil d’Etat avait donc indiqué que pour une formation de deuxième cycle qui n’est pas inscrite à cette fin sur une liste établie par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, aucune limitation à l’admission des candidats du fait des capacités d’accueil d’un établissement ou par une condition de réussite à un concours ou d’examen du dossier des candidats ne peut être introduite après l’obtention des 60 premiers crédits européens, c’est-à-dire après la première année du deuxième cycle.
En l’espèce, il n’était pas contesté que le master dans lequel le requérant souhaitait obtenir une nouvelle inscription au titre de l’année universitaire 2016-2017 ne figurait pas, à la date des décisions contestées, sur la liste annexée au décret du 25 mai 2016, décret d’application de l’article L. 212-6 du code de l’éducation. Le Tribunal administratif de Limoges en a conclu que l’Université ne pouvait se fonder sur l’appréciation des résultats obtenus par le requérant au cours de l’année universitaire 2015-2016 pour lui refuser l’inscription en deuxième année de master, alors même que, à la différence de l’affaire dont a pu connaitre le Conseil d’Etat, l’autorisation demandée était demandée pour une seconde inscription en deuxième année de master dans le cadre d’un redoublement. Le Tribunal administratif a estimé qu’aucune disposition spécifique relative au cas de redoublement ne permettait d’écarter l’application des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans son avis du 10 février 2016. Le Tribunal administratif a donc annulé le refus de redoublement opposé au requérant par l’Université de Limoges.
Environnement.
. Tribunal administratif de Limoges, 14 décembre 2017, Association Sources et Rivières du Limousin, n° 1500920, C+.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a été saisi, par l’association Sources et rivières du Limousin, d’un recours dirigé contre l’arrêté du 23 mars 2015 par lequel le préfet a autorisé le propriétaire de ruines d’un moulin et d’une usine de production d’électricité situés sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-le-Château, à disposer de l’énergie de la rivière « Le Thaurion » pour l’exploitation d’une entreprise destinée à la production d’énergie hydroélectrique pour une puissance maximale brute hydraulique fixée à 133 kilowatts.
Le tribunal, faisant application des dispositions combinées des articles L. 123-1, R. 123-4 et R. 123-19 du code de l’environnement et se référant au principe dégagé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 11 mai 2016, Société Les carrières de Saint-Lubin (n° 387908), a estimé que le commissaire-enquêteur avait exprimé un parti pris initial favorable au projet, et, ainsi, méconnu son devoir d’impartialité en mentionnant, dans ses conclusions motivées, des remarques dépréciatives à l’encontre de l’association requérante, seule personne à avoir exposé des observations contre ledit projet au cours de l’enquête publique, et que ce manquement a privé le public de la garantie qui s’attache à l’expression par le commissaire enquêteur d’une position personnelle, émise de manière objective au vu de l’ensemble du dossier d’enquête publique.
Le tribunal a également estimé que le dossier de demande d’autorisation présenté par le pétitionnaire ne précisait pas suffisamment les indications relatives aux capacités techniques et financières de ce dernier et que, eu égard à l’intérêt qui s’attache à la qualité et à l’exhaustivité de telles indications, cette insuffisance avait eu pour effet de nuire à l’information complète du public et avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision du préfet de la Creuse.
Accueillant les deux moyens précités, et estimant que les autres moyens soulevés par l’association Sources et rivières du Limousin n’étaient pas fondés, le tribunal a alors fait application des dispositions du 1° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, créé par l’article 1er de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorité environnementale, dont les dispositions sont applicables à l’autorisation en litige en vertu de l’article 15 de la même ordonnance, et qui prévoient que le juge administratif, qui estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’illégalité.
Le tribunal a, dans ces conditions, annulé l’arrêté du préfet de la Creuse du 23 mars 2015 en tant que les indications relatives aux capacités techniques et financières n’avaient pas été soumises à l’information du public de manière suffisante et en tant que le public a été privé de la garantie qui s’attache à l’expression par le commissaire enquêteur d’une position personnelle, émise de manière objective au vu de l’ensemble du dossier d’enquête publique.
Il a alors enjoint au préfet de la Creuse de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter à la phase d’enquête publique et d’inviter le pétitionnaire à préciser ses capacités techniques et financières.
Fonctionnaires et agents publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 26 octobre 2017, Mme C…, n° 1501917 et 1701289, C.
Président : M. Iselin.
Rapporteure : Mme Béria-Guillaumie.
Rapporteur public : M. Houssais.
La requérante ayant saisi le Tribunal administratif de Limoges dans les instances n° 1501917 et n° 1701289, avait été recrutée en qualité d’attachée territoriale à temps complet par le département de la Corrèze. Au cours de l’exécution de son second contrat en cette qualité, elle avait réussi les épreuves du concours d’attaché territorial et avait été inscrite sur la liste d’aptitude à compter du 1er mai 2015. Elle avait demandé au président du conseil départemental de la nommer en qualité d’attaché territorial stagiaire. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi le Tribunal administratif de Limoges d’une requête tendant d’une part, à l’annulation du refus implicite de la nommer en qualité d’attaché territorial stagiaire, et d’autre part, à l’indemnisation du préjudice subi.
Le Tribunal a statué, dans cette affaire, sur l’application des dispositions de l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant « I. Lorsqu'un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles 3-2 ou 3-3 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale (…) ». Il a rappelé que la nomination du fonctionnaire remplissant ces conditions en qualité de stagiaire constituait une obligation pour l’autorité territoriale, à condition que l’emploi correspondant existe et qu’il soit vacant dans les effectifs de la collectivité (voir jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 octobre 2016, n° 1402402).
Le Tribunal a considéré qu’en application de ces dispositions, le département avait l’obligation de nommer la requérante en qualité d’attachée territoriale stagiaire, au plus tard à la fin de son contrat en cours en septembre 2015, même si le département avait l’intention de supprimer le poste correspondant occupé à titre contractuel par la requérante. En effet, à la date de la fin du contrat de la requérante, le poste qu’elle occupait n’était pas encore supprimé, le projet de suppression ayant été seulement évoqué en comité technique paritaire, mais pas encore adopté par l’assemblée délibérante du département.
Le Tribunal a donc annulé, pour ce motif, le refus implicite du département de la Corrèze de nommer l’intéressée en qualité d’attachée territoriale stagiaire. En revanche, statuant sur les conclusions indemnitaires de la requérante, le Tribunal a tenu compte de la suppression du poste occupé par l’intéressée à la fin du mois d’octobre 2015, un mois après la date limite laissée au département pour la nommer en qualité de stagiaire. En effet, aucune disposition législative ou réglementaire, aucun principe général du droit n’imposent à l’autorité administrative qui supprime un poste occupé par un fonctionnaire stagiaire à reclasser le fonctionnaire stagiaire (Conseil d'Etat, 5 octobre 2016, Communauté d’agglomération du Douaisis, n° 386802, aux tables du recueil). Le Tribunal a donc considéré qu’en raison de la suppression ultérieure du poste sur lequel elle aurait dû être nommée en qualité d’attaché territorial stagiaire, le préjudice matériel indemnisable de la requérante ne pouvait dépasser les pertes de revenus subies au cours du mois courant entre la date limite laissée au département pour nommer la requérante en qualité de stagiaire et la suppression effective de son poste.
Pensions.
. Tribunal administratif de Limoges, 12 octobre 2017, Mme A…, n° 1600177, C+.
Magistrate désignée : Mme Béria-Guillaumie.
Rapporteur public : M. Houssais.
Le Tribunal administratif de Limoges était saisi par une requérante, fonctionnaire de l’Etat qui avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d’âge et s’était vu concéder un titre de pension. La requérante contestait le fait que sa pension de retraite n’avait pas été majorée pour handicap en application des dispositions du 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l’article R. 37 bis du même code.
Le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 décembre 2015 (n° 387624, aux tables du recueil) a précisé que la majoration de la pension de retraite n’était pas réservée aux seuls fonctionnaires admis à la retraite de manière anticipée en application des dispositions du 5° du I. de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais à tous les fonctionnaires qui remplissent les conditions de handicap et d’assurance fixées par les dispositions de l’article R. 37 bis du code. La circonstance que la requérante avait été admise à la retraite pour limite d’âge n’était donc pas de nature à l’exclure du bénéfice de la majoration pour handicap.
En l’espèce, le bénéfice de la majoration pour handicap avait été refusé à la requérante dès lors qu’à la veille de ses soixante ans, elle ne justifiait des 82 trimestres cotisés exigés par le I. de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Néanmoins, le Tribunal a rappelé que les droits à pension s’appréciaient à la date de la radiation des cadres de l’intéressé (dans un cas proche, voir le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2014, n° 1403621/5-3). Le Tribunal a donc considéré que les droits de la requérante à bénéficier de la majoration, et notamment le nombre de trimestres cotisés, devait s’apprécier à la date de la radiation des cadres de la requérante, soit en 2015, et non à la date à laquelle elle a atteint soixante ans en 2010. Le Tribunal, ayant constaté, qu’à la date de sa radiation des cadres, la requérante avait dépassé le seuil de 82 trimestres cotisés, a estimé qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la majoration de pension prévue par le 5° du I. de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et a, en conséquence, annulé le titre de pension concédé à la requérante.
Jurisprudence du 1er mai au 31 août 2017
Contributions et taxes.
. Tribunal administratif de Limoges, 13 juillet 2017, Sociétés B… et autres, n° 1500872 et suivants , C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a été saisi par des redevables (sociétés et personne physique) de la cotisation foncière des entreprises. Les litiges étaient nés de refus des services fiscaux de leur accorder le crédit d’impôt institué à l’article 1647 C septies du code général des impôts. Ce crédit d’impôt est une somme forfaitaire allouée pour chaque salarié employé par le redevable.
Après avoir considéré que le motif opposé dans le rejet des réclamations était illégal (cf. sur ce point, les points 3 à 6 du jugement), le tribunal a examiné si le nouveau motif développé par l’administration en cours d’instance était de nature à justifier légalement ce rejet (cf, sur la substitution de motif, par exemple, CE, 30.12.09, Sté Bonduelle conserve International, n° 304516, B).
Le bénéfice du crédit d’impôt est réservé, selon le 3° de l’article 1647 C septies du code général des impôts, aux redevables exploitant un « établissement situé (…) dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. ». Il s’agit de communes, dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire, situées dans une zone de restructuration de la défense (ZRD). La commune de Limoges a été inscrite sur cette liste, sur le fondement du 1° et non du 2° du 3 ter de cet article 42. L’administration fiscale a, dès lors, considéré que les redevables, exploitant un établissement à Limoges, ne pouvaient bénéficier du crédit d’impôt.
Il résulte en effet des dispositions du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 qu’il existe deux catégories de communes inscrites au sein d’une ZRD : d’une part, les communes, visées au 2°, qui sont « caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. », d’autre part, les communes, visées au 1°, qui présentent le même caractère et qui, en outre, satisfont à au moins un autre critère révélant l’existence d’un handicap économique plus large, tenant par exemple à « untaux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ».
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de substitution de motif présentée par l’administration. Il a, en effet, considéré qu’il résultait des dispositions de l’article 42modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 dont elles sont issues et qui a également institué le crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies du code général des impôts, que le législateur avait entendu inclure dans le champ d’application de cet avantage fiscal les établissements situés dans les communes visées au 1° du 3 ter de cet article. En effet, le 2° du 3 ter de cet article 42 précisait expressément que les communes étaient « le cas échéant », celles qui étaient « visées au 1° ». En outre, l’examen des travaux préparatoires a révélé que la distinction, au sein du 3 ter de l’article 42, entre deux catégories de communes n’avait été conçue que pour permettre d’isoler celles d’entre-elles sur le territoire desquelles s’appliquaient d’autres avantages fiscaux que le crédit d’impôt institué à l’article 1647 C septies du code général des impôts (notamment l’exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière pour les entreprises nouvelles). Aussi, un établissement situé dans une commune inscrite en ZRD sur le fondement du 1° du 3 ter de l’article 42, était éligible au crédit d’impôt en cause.
Ainsi, par des jugements n° 1500872 à 1500880 du 13 juillet 2017 (C+) le tribunal a accordé à chacun des redevables qui l’avait saisi le bénéfice de ce crédit d’impôt.
Marchés publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 13 juillet 2017, Société Veolia Eau-CGE, n° 1500909, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Par un jugement n° 1500909 du 13 juillet 2017 (C+), le tribunal a rejeté, pour tardiveté, le recours formé par la société Veolia Eau-CGE tendant à l’annulation d’un titre exécutoire émis par la commune d’Ambazac en vue du recouvrement de pénalités de retard dans l’exécution d’un marché de travaux publics.
La difficulté de la présente affaire concernait l’appréciation de l’existence de la mention des voies de recours, qui est une condition, prévue à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, du déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois lui-même mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Au verso du titre exécutoire, était inscrite la mention suivante « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus directement au tribunal judiciaire ou administratif compétent selon la nature de la créance ». Etaient ensuite cités dans l’acte plusieurs exemples de créances pour lesquelles est précisée la juridiction compétente. Or, les créances nées de l’exécution de marchés de travaux publics ne figuraient pas dans cette liste, ce qui était a priori de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours (cf. CE, 30.07.10, Commune de Nercillac, n° 308834 ; CE, 16.04.15, Sté Acti-Entrepôts, n° 373114).
Toutefois, le tribunal a estimé qu’en l’espèce l’omission de l’indication, dans le titre exécutoire, du rattachement à la compétence du tribunal administratif du contentieux relatif à une créance née de l’exécution d’un marché de travaux publics n’était pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. En effet, l’article 35 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux publics conclu entre la commune d’Ambazac et le groupement dont faisait partie la société Veolia Eau-CGE et signé par celle-ci, mentionnait la compétence du tribunal administratif s’agissant d’un différend relatif à l’exécution des prestations objet de ce marché. Le tribunal a ainsi considéré que, par le rapprochement entre les mentions de ces stipulations et celles du titre exécutoire, la société pouvait être regardée comme ayant été informée des voies de recours.
Jurisprudence du 1er janvier au 30 avril 2017.
Comptabilité publique et budget.
. Tribunal administratif de Limoges, 5 avril 2017, M. ….., n° 1500454.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
En vue d’obtenir le recouvrement d’une somme de 5 000 euros correspondant à une partie du coût d’une formation à laquelle a participé M. L., l’Institut français du cheval et de l’équitation, établissement public de l’Etat a émis, le 8 novembre 2012, un premier titre exécutoire. M. L. a obtenu devant le tribunal, par un jugement du 20 mars 2014 devenu définitif, l’annulation de ce titre exécutoire pour un vice de forme et, par voie de conséquence, la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 000 euros. Le 31 décembre 2014, l’Institut français du cheval et de l’équitation, poursuivant toujours le recouvrement de cette somme, a émis un second titre exécutoire à l’encontre de M. L.
Ce titre exécutoire a également été annulé par le tribunal dans le jugement n° 1500454 du 5 avril 2017 pour un motif de fond. La formation de jugement a en effet considéré que la créance était prescrite. Les règles de prescription applicables sont celles des articles 2224 et suivants du code civil. Le délai de prescription (5 ans) courait en l’espèce à compter du 21 juillet 2008. Le tribunal a estimé que le seul fait susceptible d’interrompre le délai de prescription était l’émission, le 8 novembre 2012, du titre exécutoire. Toutefois, ce titre exécutoire a été annulé par le jugement du 20 mars 2014 et cette annulation, qui avait pour conséquence que cet acte était réputé n’avoir jamais existé, faisait dès lors obstacle à ce que soit attaché audit acte un effet interruptif de prescription (Cf. CAA Bdx, 3 décembre 2015, 13BX01515). Par ailleurs, si l’article 2241 du code civil énonce que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. », le tribunal a estimé que ces dispositions ne visaient que la demande en justice formée par le créancier et que, par suite, le recours que M. L. avait en l’espèce formé contre le titre exécutoire émis le 8 novembre 2012 n’avait pas interrompu le délai de prescription. En conséquence, le tribunal a considéré qu’au 31 décembre 2014, date d’émission du titre exécutoire en litige, la créance était prescrite.
Fonctionnaires et agents publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 28 avril 2017, M….., n° 1501681, 1600893.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : Mme Béria-Guillaumie.
Rapporteur public : M. Houssais.
Le tribunal était saisi, par un fonctionnaire territorial ayant fait l’objet d’une exclusion disciplinaire des fonctions pendant une durée de dix-huit mois, de conclusions dirigées contre plusieurs mesures adoptées par son employeur lors de son retour en fonctions après accomplissement de sa période d’exclusion.
Le fonctionnaire contestait notamment un courrier par lequel son autorité hiérarchique, le directeur général de l’Office public de l'habitat de la Corrèze, l’avait affecté, au retour de son exclusion de fonctions, sur un poste au sein de l’agence d’Ussel de l’Office public de l'habitat, alors qu’avant son exclusion, l’intéressé était affecté sur un poste au sein de l’agence de Tulle de l’Office public de l'habitat.
Le requérant contestait cette mesure d’affectation dès lors qu’il n’avait pas été affecté, à l’issue de son exclusion disciplinaire, sur son ancien poste. Le Tribunal a souligné que dans le cas d’une suspension de fonctions à titre disciplinaire, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative d’affecter l’agent sanctionné dans le même poste que celui qu’il occupait avant l’exécution de sa sanction. Ayant, en outre, relevé que le nouveau poste auquel l’intéressé avait été affecté correspondait au grade de l’agent, le Tribunal a écarté ce moyen.
Transports.
.Tribunal administratif de Limoges, 23 février 2017, Société Garage du Rempart, Société d’exploitation du garage de Robinson et société Avenir Automobile 78, n° 1401770, 1401782 et 1401783
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : M. Houssais.
Le tribunal administratif était saisi de recours en annulation de trois titres exécutoires émis par l’Agence de services et de paiement (ASP) à l’encontre de concessionnaires automobiles, dans le cadre de l’ancien dispositif du « bonus écologique ».
Les trois sociétés requérantes avaient en effet conclu, sur la base de l’article 6 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, une convention avec l’ASP permettant au vendeur d’un véhicule « propre » de faire bénéficier son client de l’avance du montant de l’aide à l’acquisition de ce véhicule.
La société Garage du Rempart, la société d’exploitation du garage de Robinson et la société Avenir Automobile 78 ont ainsi vendu à la société Evercar France plusieurs véhicules en déduisant de la facture un montant hors taxe de 7 000 euros par automobile, correspondant au bonus écologique. Les sociétés ont par suite transmis une demande remboursement à l’ASP, qui leur a accordé.
L’établissement public a toutefois émis des ordres de reversement estimant, à la suite de contrôles, que l’ensemble des conditions du versement de l’aide n’étaient pas remplies.
Les requérantes se prévalaient tout d’abord de plusieurs irrégularités procédurales. Il était notamment fait état de ce que l’ASP ne leur avait pas précisé le numéro de châssis des véhicules contrôlés, contrairement aux stipulations de l’article 5 des conventions signées entre les parties. Le tribunal a toutefois estimé que cette circonstance était sans incidence sur la légalité des ordres de recouvrement contestés dans la mesure où l’administration avait communiqué des informations permettant aux intéressées d’identifier sans aucune difficulté les dossiers faisant l’objet du contrôle.
De même, la formation de jugement a estimé que le dépassement du délai de trente jours contractuellement fixé pour la notification par l’ASP des résultats de son contrôle ne viciait pas la procédure. Il a en effet été relevé que l’acte contractuel ne prescrivait pas ce délai à peine de nullité et, en outre, que le dépassement de ce délai n’avait privé les sociétés requérantes d’aucune garantie.
Au fond, le tribunal a dû se prononcer sur l’exactitude du fondement des ordres de reversement litigieux, l’ASP ayant retenu que le bonus écologique avait été indument versé à la société Garage du Rempart, la société d’exploitation du garage de Robinson et la société Avenir Automobile 78 dans la mesure où l’entreprise Evercar France, acquéreuse des véhicules, les avait ensuite cédés à la société Evercar Belgique en tant que véhicules neufs. Cette circonstance méconnaissait directement le 4° de l’article 1er du décret du 26 décembre 2007.
D’une part, et en l’absence de définition de la notion de « véhicule neuf » au sein de ce décret, dans sa version applicable au litige, le tribunal a estimé que le pouvoir règlementaire devait être regardé comme s’en étant implicitement mais nécessairement remis à la définition fiscale du véhicule neuf telle qu’elle figurait déjà à l’article 298 sexies du code général des impôts. C’est en effet cette définition, selon laquelle sont considérés comme neufs les véhicules dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres, qui a été reprise à l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 dans sa version applicable après le 31 décembre 2013.
D’autre part, si les sociétés requérantes contestaient l’existence d’une véritable cession entre les entreprises Evercar France et Evercar Belgique, qui seraient deux établissements appartenant à Evercar SPRL, il a été jugé que la production au dossier de certificats de cession précisant que les véhicules avaient bien fait l’objet d’une « vente » faisait obstacle à l’abandon d’une telle qualification. Il a en outre été relevé que si les sociétés soutenaient que les opérations litigieuses ne constituaient que des « mouvements de biens » au sens de la doctrine fiscale, elles ne justifiaient nullement de la réunion des conditions posées par l’instruction qu’elles invoquaient.
Dès lors, prenant en compte la concomitance entre l’immatriculation des véhicules vendus par les trois sociétés requérantes à l’entreprise Evercar France et la revente de ceux-ci à Evercar Belgique, le tribunal a estimé que l’ASP n’avait commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits en retenant que les automobiles vendues à Evercar France étaient destinées à être vendues par cette dernière en tant que véhicules neufs.
Jurisprudence du 1er septembre au 31 décembre 2016.
Collectivités territoriales.
. Tribunal administratif de Limoges, 20 décembre 2016, Mme A…, Mme E…., Mme C… n°1501309.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Par un jugement n°1501309 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif a annulé la décision du 15 juin 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé la délivrance d’agréments pour l’exercice de la profession d’assistant maternel au sein d’une maison d’assistants maternels.
Pour annuler cette décision, le tribunal a retenu un vice de procédure invoqué par les trois requérantes, à qui l’agrément avait été refusé, et a estimé que ce vice de procédure était constitutif d’une illégalité dès lors qu’il avait privé les intéressées d’une garantie – Sur l’office du juge ayant identifié l’existence d’un vice de procédure, voir CE (Ass), 29 décembre 2011, M. D., n°335477, Recueil Lebon ; CE (avis), 30 décembre 2013, Mme O, n°367615, Recueil Lebon.
Le vice de procédure procédait de l’absence, au cours de l’instruction de la demande d’agréments, de visite organisée sur le lieu d’exercice de la profession, soit les locaux abritant la maison d’assistants maternels. En effet, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 421-3, R. 421-5 et D. 421-4 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que de celles du référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels annexé au décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 que lorsque le président du conseil départemental est saisi, par plusieurs personnes souhaitant exercer dans une maison d'assistants maternels cette profession et ne disposant pas encore de l'agrément individuel défini à l'article L. 421-3 du code, d’une demande tendant à la délivrance, à chacune d’elles, de cet agrément, l'instruction de cette demande implique l’organisation de visite(s) sur leur lieu d’exercice correspondant, dans ce cas, aux locaux prévus pour l’exercice effectif de la profession d'assistant maternel.
Pour estimer que ce vice de procédure avait privé en l’espèce les intéressées d’une garantie, le tribunal a relevé que les motifs opposés par le président du conseil général de la Haute-Vienne (caractère conséquent de l’offre d’accueil d’enfants au sein de structures collectives ; absence de référent extérieur, nombre et qualifications des personnels limités par rapport à un établissement d’accueil collectif de jeunes enfants) n’étaient pas au nombre de ceux qu’un président de conseil général pouvait légalement opposer pour refuser la délivrance d’agréments. En effet, seule la non-satisfaction des critères prévus à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et fixés par l’annexe 4-8 au décret du 15 mars 2012, tenant aux conditions d'accueil qui doivent garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs, peut justifier un tel refus. Précisément, la visite sur le lieu d’exercice de la profession permet aux services instructeurs de fournir à l’auteur de la décision des éléments d’appréciation du respect de ces critères.
Fonctionnaires et agents publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 22 septembre 2016, Syndicat Inter 87/FSU, Mme …., M. …, n°14436, 14469, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : M. Houssais.
Un arrêté du 9 janvier 2013 portant extension du périmètre de la communauté d’agglomération Limoges Métropole y a intégré, avec effet au 1er janvier 2014, la commune de Couzeix auparavant membre de la communauté de communes l’Aurence Glane Développement.
Cette intégration a entraîné le transfert d’une partie des compétences de la communauté de communes l’Aurence Glane Développement à la communauté d’agglomération, notamment la gestion de la déchèterie et du service public d’assainissement non collectif.
Parallèlement à ce transfert de compétences, la commune de Couzeix, la communauté de communes l’Aurence Glane Développement et la communauté d’agglomération Limoges Métropole ont signé, les 19, 20 et 27 décembre 2013, une « convention » prévoyant le transfert de certains agents de la communauté de communes à la commune de Couzeix puis, simultanément, vers Limoges Métropole.
Le tribunal était saisi de trois recours pour excès de pouvoir formés par le syndicat Inter 87/FSU ainsi que Mme A et M. B, deux agents transférés de la communauté de commune l’Aurence Glane Développement à la communauté d’agglomération Limoges Métropole par le biais de la « convention » précitée. Ces recours visaient l’annulation tant de l’acte tripartite signé les 19, 10 et 27 décembre que des différents arrêtés individuels pris sur son fondement et organisant le transfert de Mme A et M. B.
Le tribunal s’est, tout d’abord, référé au principe dégagé par le Conseil d’Etat dans sa décision du 5 juillet 2013, commune de Ligugé (n° 366552). La Haute juridiction est venue y préciser que les dispositions de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivité territoriale «n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer, dans le cas où une commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle avait adhéré, le transfert des personnels affectés au fonctionnement d’un équipement que la commune avait mis à disposition de cet établissement pour l’exercice d’une compétence communautaire et dont elle reprend la gestion ».
Le tribunal a ainsi estimé que le retrait d’une commune d’un EPCI n’entraînant, en lui-même, aucun transfert de fonctionnaires, les collectivités ne pouvaient se fonder sur les dispositions de l’article L. 5211-4-1 précité pour édicter leur acte conjoint. Le départ de Mme A et M. B de la communauté de communes l’Aurence Glane Développement ne pouvait ainsi avoir lieu que dans le cadre de procédures de droit commun.
A ce titre, si l’administration faisait valoir en défense avoir entendu se placer dans le cadre de la procédure de reclassement, il a été jugé qu’il ressortait des pièces du dossier que la procédure particulière prévue à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et notamment l’obligation de saisir pour avis le comité technique paritaire sur les suppressions d’emplois, n’avait pas été respectée.
Le tribunal a donc annulé pour erreur de droit l’acte adopté conjointement entre la communauté de communes l’Aurence Glane Développement, la communauté d’agglomération Limoges Métropole et la commune de Couzeix. Il a également été fait droit, par voie de conséquence, aux conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’ensemble des arrêtés individuels pris sur le fondement de la « convention » pour régler la situation de Mme A et M. B.
Procédure.
. Tribunal administratif de Limoges, 6 octobre 2016, Mme C…., n°1400545, C.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : Mme Béria-Guillaumie.
Rapporteur public : M. Houssais.
. Tribunal administratif de Limoges, 10 novembre 2016, M. D…., n°1400847, C+.
Président-Rapporteur : M. Gensac.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a fait application, dans deux jugements, de l’arrêt du 13 juillet 2016n° 387763 à l’exception d’illégalité dont il a estimé qu’elle devait, au regard du principe de sécurité juridique, être soulevée dans un délai raisonnable pour être recevable, condition non réunie en l’espèce.
Dans la première affaire, Mme C…. contestait une décision par laquelle la Poste avait refusé de l’inscrire par la voie de la reconnaissance de l’expérience professionnelle à un grade de niveau supérieur, en invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de son intégration dans un corps de reclassification plusieurs années auparavant.
Le tribunal a constaté que la requérante avait eu nécessairement connaissance, même si les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de la décision ne lui avaient pas été indiqués, du refus de la Poste de la nommer dans un corps de reclassification par une décision de 2002, à l’encontre de laquelle elle avait exercé plusieurs recours administratifs et que cette décision ne pouvait être contestée, y compris par la voie de l’exception d’illégalité, au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance du refus de 2002.
Dans la seconde affaire, pour contester le fondement de l’opposition à tiers détenteur du 11 février 2014, M. D… soulève un seul moyen tiré de l’exception d'illégalité du titre exécutoire, émis à son encontre le 23 mai 2005, sur le fondement duquel il a été pris, mettant à sa charge la somme de 41 482,11 euros.
Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été destinataire, au plus tard, par un bordereau en date du 19 décembre 2005, des copies respectives du titre exécutoire du 23 mai 2005, du commandement de payer et du jugement du tribunal en date du 23 septembre 1999. Si une telle notification du titre exécutoire est incomplète, et ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, dès lors qu’elle indique que le destinataire peut « contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance » et que les exemples cités pour illustrer cette possibilité ne comprennent pas la créance en cause, et si, par suite, le délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne lui était pas opposable, le tribunal a toutefois estimé que l’exception d’illégalité dont se prévaut le requérant a été soulevé neuf années après la notification du titre exécutoire, survenue à la date de réception du bordereau du 19 décembre 2005. Il a considéré qu’elle excédait le délai raisonnable durant lequel elle pouvait être invoquée et n’était donc pas recevable.
Urbanisme et aménagement du territoire.
. tribunal administratif de Limoges, 29 septembre 2016, Mme C…., n°1401342, C+.
tribunal administratif de Limoges, 29 septembre 2016, M. D… , n°1401396, C+.
Président : M. Gensac.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a été saisi de recours pour excès de pouvoir dirigés contre des décisions prorogeant la durée de validité de permis de construire en application de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme. Il a, par deux jugements du 29 septembre 2016, rejeté ces recours pour irrecevabilité. Il a estimé que le premier recours (n°1401342) n’avait pas donné lieu à l’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du même code. Il a considéré que l’auteur du second recours (n°1401396) ne justifiait pas d’un intérêt à agir, lequel a été apprécié au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 de ce code.
L’intérêt juridique de ces deux jugements porte sur le champ d’application des dispositions de ces articles. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ». Selon l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) ».
Ces dispositions visent les recours dirigés contre un permis de construire. Or, les recours étaient en l’espèce dirigés contre, non pas des permis de construire mais des décisions prorogeant la durée de validité de telles autorisations. Toutefois, eu égard à l’objet de telles décisions qui permettent au bénéficiaire du permis de construire de poursuivre l’exécution des travaux autorisés, et prolongent ainsi les effets attachés à la délivrance de cette autorisation, le tribunal a estimé que les dispositions des articles L. 600-1-2 et R. 600-1 du code de l’urbanisme devaient être appliquées aux recours dirigés contre les décisions de prorogation d’un permis de construire alors même que ces dernières ne sont pas expressément visées par ces dispositions. Par ailleurs, concernant l’article R. 600-1, le tribunal a estimé que, conformément à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, la mention de l’existence de l’obligation de notification devait figurer sur le panneau d’affichage d’une décision de prorogation d’un permis de construire, qui doit être implanté sur le terrain d’assiette du projet. A défaut, l’absence d’accomplissement de l’obligation de notification est inopposable au requérant (cf. sur la portée de l’absence de la mention de l’obligation de notification sur le panneau d’affichage d’un permis de construire - CE, avis, 19 novembre 2008, n°317279, Rec. p 429).
Jurisprudence du 1er mai au 31 août 2016.
Fonctionnaires et agents publics.
. tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2016, Mme B, n°141411.
Juge unique : M. Houssais.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Une professeure d’arts plastiques certifiée, affectée à des fonctions purement administratives au sein du rectorat à la suite de la reconnaissance de son inaptitude définitive aux fonctions d’enseignant, contestait la notation qui lui avait été attribuée au titre de l’année 2013.
L’intéressée soutenait qu’eu égard à ses fonctions, elle aurait dû être évaluée conformément aux dispositions applicables aux personnels administratifs de l’éducation nationale et, dans ces conditions, bénéficier d’un entretien d’évaluation préalable avec son supérieur hiérarchique en application des dispositions du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010.
Le tribunal a tout d’abord rappelé qu’en dépit des fonctions administratives qui lui étaient dévolues, la requérante n’avait pas fait l’objet d’un reclassement et continuait donc de se voir appliquer les dispositions du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
Dans un second temps, le tribunal a constaté que le corps des professeurs certifiés n’était pas au nombre des corps visés par l’arrêté du 18 mars 2013 fixant la liste des corps relevant du ministre de l’éducation nationale soumis aux dispositions du décret du 28 juillet 2010 et a ainsi conclu à l’absence d’obligation d’entretien professionnel à l’égard des professeurs certifiés.
Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’étant pas davantage fondé, le tribunal a donc rejeté la requête qui lui était soumise.
. tribunal administratif de Limoges, 26 mai 2016, Mme B…, n°131591
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif était saisi d’un recours pour excès de pouvoir présenté par Mme … greffière au tribunal de grande instance de Limoges, visant à obtenir l’annulation d’une décision du 13 mai 2013 limitant à un mois sa bonification de réduction d’ancienneté dans son échelon. Mme B. demandait également l’annulation d’une décision du 19 juillet suivant par laquelle le ministre de la justice avait rejeté son recours administratif préalable, présenté sur le fondement du 1° de l’article 1er du décret n°2012-765 expérimentant le recours administratif préalable obligatoire dans le cadre de certains actes relatifs à la situation personnelle des agents de l’Etat.
Sur ce dernier point, le tribunal a fait droit à l’argumentation du garde des sceaux, qui estimait que le cas de Mme B. n’entrait pas dans le cadre de ces dispositions. Il a, en effet, été jugé qu’une décision attribuant une bonification d’ancienneté dans l’échelon, qui concerne l’avancement des fonctionnaires, ne se rapporte pas aux « éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ». Le tribunal a ainsi estimé que le litige se situant en dehors du champ d’application des dispositions du 1° de l’article 1er du décret n°2012-765 dont se prévalait Mme B. la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté le recours de l’intéressée devait être regardée comme un rejet de recours gracieux qui, contrairement au rejet d’un recours administratif préalable obligatoire, ne se substituait pas au rejet initial.
Au fond, le tribunal a tout d’abord écarté l’ensemble des moyens tirés de vices de procédure soulevés à l’encontre de la décision du 19 juillet 2013 par application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 11 juillet 2012, (n°343866). A ce titre, dans le cas où un requérant présente dans la même requête des conclusions à fin d’annulation dirigées à la fois contre une décision initiale et contre le rejet du recours gracieux ou hiérarchique présenté à son encontre, les moyens tirés des vices propres dont serait entachée la seconde sont inopérants.
Sur la limitation de la réduction d’ancienneté de Mme B, il a été jugé que la requérante ne contestait nullement les éléments précis et circonstanciés apportés par le ministre, qui faisait valoir que le dossier de Mme B avait été soumis à une commission d’harmonisation et qu’avaient été retenus pour l’attribution des bonifications les critères de charges de travail nouvelles suite à une vacance ou à une suppression de poste, à des absences prolongées afin d’assurer la continuité du service public de la justice, ou encore le surcroît de travail lié à la résorption des retards dans les services ou à l’application de réformes à effectif constant. Mme B n’établissait en outre pas que des agents ayant obtenu des résultats d’évaluation comparables auraient bénéficié d’une réduction d’ancienneté supérieure.
Enfin, le tribunal a jugé que le ministre ne portait pas atteinte au principe d’égalité, en limitant à 10 % des effectifs le nombre d’agents pouvant obtenir une réduction d’ancienneté de trois mois et à 20 % ceux pouvant obtenir une réduction de deux mois, dans la mesure où cette règle vise à faire bénéficier un pourcentage d’agents de modalités d’avancement plus favorables en se basant sur un critère objectif, à savoir leur mérite professionnel.
Marchés publics et contrats administratifs
. tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2016, Sté X…, n°1300628, C+.
Président-rapporteur : Mme Jayat
Rapporteur public : M. Debrion.
Une société, membre d’un groupement candidat à un appel d’offres lancé par un établissement hospitalier en vue de la passation d’un marché d’assurances comportant notamment un lot n° 1 « Responsabilité civile et risques annexes », a saisi le tribunal d’un recours « Tropic » dirigé contre le marché, finalement attribué à un autre candidat.
L’article 52 du code des marchés public alors en vigueur distinguait notamment pour les marchés sur appel d’offres, la phase de sélection des candidatures à un marché public de la phase d’attribution du marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, après élimination, notamment, en application du III de l’article 53, des offres que leur teneur, incomplète, rend irrégulières. Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de l’expérience professionnelle du candidat, qui est relative à l’aptitude de ce candidat à exécuter le marché à attribuer, peut être utilisée pour sélectionner les candidatures, mais elle ne peut, en revanche, pas être utilisée pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction de l’objet du marché et de la nature des prestations à réaliser.
En l’espèce, il résultait notamment du rapport d’analyse des offres et d’un courrier adressé par le centre hospitalier au conseil de la société requérante, que, pour évaluer les offres au regard du sous-critère relatif aux méthodes, aux outils et aux délais de gestion, le pouvoir adjudicateur s’était fondé entre autres sur l’expérience des candidats et sur leur connaissance du secteur et des contentieux liés à l’objet du marché. Sur ce point, l’établissement hospitalier avait relevé que le groupement dont la société requérante était membre était implanté récemment sur le marché français, depuis moins de cinq ans, et que, par conséquent, il manquait de recul et de visibilité quant à la gestion du contentieux.
Le centre hospitalier et l’assureur dont l’offre a été retenue exposaient en défense que l’expérience des candidats peut être déterminante dans la fiabilité de l’offre compte tenu des spécificités du secteur de l’assurance.
Mais le tribunal a estimé que l’appréciation qui avait été ainsi portée par le pouvoir adjudicateur concernait, non la valeur intrinsèque de l’offre, mais l’aptitude du candidat à exécuter le type de prestations qui faisait l’objet du marché. Or, l’appréciation de l’expérience ne pouvait être légalement utilisée que pour sélectionner les candidats aptes à exécuter le marché à attribuer et non pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse. Le tribunal a donc, notamment pour ce motif, jugé que le marché était entaché d’illégalité. Le juge du référé précontractuel du TA de Toulouse a antérieurement adopté une solution semblable dans une affaire qui concernait la même société (TA Toulouse 10 décembre 2012 X … n° 1205236).
Quant aux conséquences de cette illégalité, le tribunal, après avoir estimé que le groupement dont la société requérante était membre avait des chances sérieuses de remporter le marché, a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 232 807 euros en indemnisation de son manque à gagner. Il a, en revanche, autorisé la poursuite de l’exécution du contrat, dont le terme était fixé au 31 décembre 2016, dès lors qu’il n’apparaissait pas que le centre hospitalier avait eu la volonté de favoriser un candidat et que cet établissement aurait dû, en cas de résiliation du contrat, engager dans des délais excessivement brefs une nouvelle procédure de marché, pour souscrire, conformément à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, une assurance garantissant sa responsabilité civile.
. Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2016, SARL Decutis, n°131265.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
La société D… s’est vue confier, dans le cadre d’un marché portant sur des travaux de construction et de reconstruction des locaux de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Bruyère de Neuvic d’Ussel, le lot n°1 « Désamiantage-Démolition ». Le 6 juin 2013, l’Ehpad a décidé de prononcer la résiliation du marché conclu avec la société D… aux torts exclusifs de la société. Cette société a notamment saisi le tribunal de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
Constatant que l’Ehpad avait conclu, postérieurement à la résiliation en litige, un marché de substitution pour le désamiantage et la démolition de ses immeubles, et que ces travaux, exécutés en octobre 2013, avaient fait l’objet d’une réception au mois de mars 2016, le Tribunal a jugé que les conclusions présentées par la société D… tendant à la reprise des relations contractuelles étaient désormais dépourvues d’objet et qu’il n’y avait, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Responsabilité de la puissance publique.
. Tribunal administratif de Limoges, 28 avril 2016, M. B.….., n°131333.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
M. B a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Limoges le 8 août 2011 pour le traitement d’un syndrome coronarien aigu. Le lendemain, alors que M. B présentait des troubles cardiaques, le centre hospitalier a décidé de mettre en place une sonde d’entrainement électro-systolique. Lors du retrait de cette sonde, le 11 août 2011, M. B a été victime d’une tamponnade, ce qui a entraîné une nouvelle admission de l’intéressé au bloc opératoire pour stopper l’hémorragie causée par cet accident et éliminer le sang présent dans son péricarde. M. B est resté hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Limoges jusqu’au 24 août 2011 avant d’être transféré au centre de réadaptation de Sainte-Feyre (Creuse) qu’il quittera le 17 septembre 2011 pour reprendre, le 3 octobre 2011, son activité libérale de chirurgien-dentiste.
Le Tribunal, saisi par M. B de conclusions indemnitaires dirigées contre l’établissement public d’hospitalisation, a constaté que le centre hospitalier universitaire de Limoges n’avait pas établi de compte-rendu opératoire retraçant les opérations de pose et d’enlèvement de la sonde d’entraînement électro-systolique. Estimant que ces opérations ne pouvaient être qualifiées de gestes courants et bénins et, qu’en conséquence, le centre hospitalier était tenu, en application des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, d’établir un compte-rendu opératoire, le Tribunal a jugé qu’il incombait au centre hospitalier universitaire de Limoges de rapporteur la preuve de l’absence de faute commise de sa part dès lors que le défaut de réalisation de ces éléments médicaux avait privé le requérant de documents indispensables pour établir les fautes reprochées relatives aux conditions d’implantation de la sonde d’entraînement. En l’absence de production d’éléments susceptibles d’apporter cette preuve, le Tribunal en a alors conclu que l’établissement public hospitalier avait commis une faute, lors de la pose de la sonde d’entraînement, de nature à engager sa responsabilité.
Travail
. tribunal administratif de Limoges, 2 juin 2016, Mme B., n°1401434, C+.
Président- rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
Une employée de caisse d’une grande surface, salariée protégée car investie de fonctions représentatives, a saisi le tribunal d’un recours dirigé contre la décision par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé son employeur à la licencier.
Accusée de vol dans le magasin où elle était employée, elle soutenait que l’administration ne pouvait pas légalement s’appuyer, pour autoriser son licenciement, sur les faits tels qu’ils avaient été enregistrés par le système de vidéosurveillance du magasin.
L’enregistrement, faute d’avoir été versé à la procédure pénale engagée contre la salariée, devait être détruit dans le délai maximum de trente jours, conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral autorisant le système de vidéosurveillance et conformément à l’article 10 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 alors en vigueur, soit en l’espèce le 30 octobre 2011. Il ne pouvait donc pas légalement être transcrit par un huissier de justice le 30 janvier 2012 comme cela avait été fait. Mais, le tribunal a constaté que les images enregistrées avaient été précédemment visionnées et leur déroulement précisément décrit, lors de la séance du comité d’établissement du 11 octobre 2011, à laquelle la salariée était présente.
Il a donc estimé que le ministre avait pu s’appuyer, pour prendre la décision attaquée, sur les éléments résultant de l’enregistrement de vidéosurveillance du 30 septembre 2011, tels qu’ils avaient été décrits lors de la séance du comité d’établissement du 11 octobre 2011. Il a écarté la contestation de la requérante, après avoir également estimé que le ministre ne s’était pas fondé, pour prendre la décision attaquée, sur des éléments substantiels du procès-verbal établi par huissier de justice le 30 janvier 2012 autres que ceux qui figuraient déjà dans le procès-verbal de la réunion du comité d’établissement du 11 octobre 2011.
Jurisprudence du 1er janvier au 30 avril 2016.
Agriculture, chasse et pêche.
. Tribunal administratif de Limoges, 28 janvier 2016, Association pour la protection des animaux sauvages, n°1301582.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi d’une requête de l’Association pour la protection des animaux sauvages tendant à l’annulation d’un arrêté du préfet de la Corrèze modifiant le schéma départemental de gestion cynégétique, définissant, notamment, des territoires dans lesquels pouvait être autorisée la destruction des martres par piégeage et des pies bavardes par piégeage et tir.
Le tribunal administratif a rappelé que l’arrêté du 2 août 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles permet, notamment, le piégeage de la martre et le tir de la pie bavarde dans des territoires désignés par le schéma départemental de gestion cynégétique où sont mises en œuvre« des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs ».
Or le Tribunal a constaté que ni les seules mentions, générales, du schéma départemental de gestion cynégétique, ni les quelques éléments généraux compris dans le schéma ne permettaient d’attester que la régulation de la prédation d’espèces, comme le lièvre d’Europe, le faisan commun, le lapin de Garenne, et le canard colvert, était nécessaire à la conservation ou la restauration de ces espèces. Dès lors que la nécessité de la régulation des prédateurs découlait des dispositions de l’arrêté du 2 août 2012 et qu’il a estimé que ni le préfet de la Corrèze, ni la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze n’apportaient suffisamment d’éléments pour établir cette nécessité, le tribunal administratif a estimé qu’en approuvant la révision du schéma départemental de gestion cynégétique, le préfet de la Corrèze avait commis une erreur d’appréciation et a annulé, pour ce motif, l’arrêté portant révision de ce schéma.
Aide sociale.
. Tribunal administratif de Limoges, 10 mars 2016, Mme B…,n°1400635.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
Mme B … est bénéficiaire du revenu de solidarité active et, à ce titre, le département de la Haute-Vienne lui a demandé de signer un « contrat d’engagements réciproques » ayant pour objet de décrire les engagements réciproques du département et de l’allocataire en matière d’insertion sociale ou professionnelle, contrat prévu par l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles. Ayant refusé de signer un tel contrat, Mme B a été rendue destinataire d’une décision prise par le département de la Haute-Vienne l’obligeant à procéder à la signature de ce contrat d’engagements réciproques. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal.
Selon une jurisprudence récente du Conseil d’État (CE, 15 décembre 2015, M. A…, 377138, B), le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 et un contrat doit être conclu avec celui-ci afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion. Il s’ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il rencontre des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé faisant obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, d’entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le bénéficiaire ne peut être exempté de signer ce contrat que pour un motif légitime qu’il lui appartient de justifier.
En l’espèce, Mme B … a refusé de signer le contrat d’engagements réciproques en faisant état, d’une part, de sa volonté de consacrer son temps à ses deux filles et aux tâches ménagères du foyer et, d’autre part, de la circonstance qu’elle n’avait, selon elle, aucune chance de trouver un emploi en qualité d’assistante maternelle du fait de sa confession musulmane et de la tenue qu’elle estime devoir porter « par foi et conviction personnelle ».
Le Tribunal a toutefois estimé que de tels motifs ne constituaient pas un « motif légitime » justifiant de ne pas signer le contrat prévu par l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles qui correspond à l’un des devoirs soit de l’allocataire du revenu de solidarité active soit du conjoint d’un tel allocataire.
. Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2016, Mme B…,n°1401405
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
Par une décision du 11 juin 2014, le département de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé par Mme B … contre la décision du 23 janvier 2014 de la caisse d’allocations familiales (C.A.F) de la Haute-Vienne qui lui a notifié des indus de revenu de solidarité active (RSA) « activité » et « socle ».
En premier lieu, le Tribunal a rappelé que le bénéficiaire du RSA à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation avait été notifiée, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pouvait contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants. Il a également rappelé que les dispositions de l’article L. 262-47 du même code instaurant un recours administratif préalable obligatoire étaient applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci et non à celles qui le sont, au nom de l’Etat, par l’organisme chargé du service du RSA. Il en a déduit que le recours de Mme B … devait être regardé comme dirigé, en matière de RSA « socle », contre la seule décision prise par le président du conseil départemental le 11 juin 2014, laquelle s’était substituée à la décision du 23 janvier 2014 prise par la caisse d’allocation familiales au nom du département, et, en matière de RSA « activité », contre la décision initiale du 23 janvier 2014 prise par la caisse d’allocations familiales au nom de l’Etat et contre la décision du 11 juin 2014 prise par le président du conseil départemental sur recours administratif non obligatoire.
En second lieu, le Tribunal a retenu le moyen soulevé par la requérante tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées. Il a relevé que ces décisions ne faisaient pas apparaître les données chiffrées qui avaient été prises en compte pour établir les deux montants des indus de RSA « activité » et « socle » et ne mentionnaient ni la période sur laquelle avait porté le contrôle sur les relevés bancaires de Mme B … ni la période à laquelle se rattachaient les revenus pris en compte. Le Tribunal a en conséquence annulé les décisions litigieuses.
Collectivités territoriales.
. Tribunal administratif de Limoges, 4 février 2016, M G……, n°1301706, C+.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal a annulé, à la demande d’un conseiller municipal de Panazol, la délibération du 1er octobre 2013 par laquelle ce conseil municipal a décidé de céder à l’association Delta plus des parcelles appartenant au domaine privé de la commune, au prix de 32 250 euros. Cette acquisition était en lien avec un projet d’extension de l’activité de l’association qui gère des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap.
Le motif d’annulation a pour base légale les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Ces dispositions reconnaissent aux conseillers municipaux un droit à l’information dont l’exercice se concrétise, notamment, par la possibilité de poser des questions au cours des séances de conseil municipal.
Au cours de la séance du 1er octobre 2013, le requérant a interrogé le maire sur l’écart entre le prix au mètre carré des parcelles dont la cession a été approuvée, qui était égal à 0,80 euro, et le prix d’acquisition par la même association de parcelles attenantes, qui avait été approuvé en 2011 et qui était égal à 7,27 euros. A la suite d’une première réponse du maire indiquant que cette différence de prix s’expliquait notamment par l’inscription en zone « non constructible » d’une partie « importante » des parcelles au cœur de la cession en litige, le requérant a demandé au maire de préciser l’étendue exacte des surfaces des parties « constructible » et « non constructible ». Le maire n’a pas apporté ces précisions.
Le tribunal a estimé que cette absence de réponse constituait une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. En effet, le prix de 0,80 euro par mètre carré correspondait au prix de vente d’un terrain classé intégralement en zone naturelle, alors que seuls 30% de la superficie des parcelles cédées étaient classées au sein de cette zone. Ainsi, les précisions demandées par le requérant auraient constitué, compte tenu de l’importance des surfaces constructibles, un élément déterminant pour la discussion sur les conditions de la cession, notamment sur le prix retenu de 0,80 euro par mètre carré. Cette insuffisante information a privé, en l’espèce, les membres du conseil municipal de Panazol d’une garantie et, au surplus, a pu exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, et notamment sur le prix.
Contributions et taxes.
. Tribunal administratif de Limoges, 3 mars 2016, M. E…, n°131662, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi par un requérant qui demandait la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l’année 2012, en raison de la prise en compte, pour la détermination de son quotient familial, de son mariage intervenu en décembre 2012. Le mariage du requérant avait été célébré le 21 décembre 2012 aux Philippines, mais n’avait été transcrit sur les registres de l’état civil français, en application de l’article 171-5 du code civil, que le 2 mai 2013. L’administration fiscale n’avait retenu que cette dernière date pour prendre en compte le mariage du contribuable dans le calcul de son quotient familial (article 193 et suivants du code général des impôts).
Le Tribunal a rappelé qu’en application des dispositions des articles 171-5 à 171-8 du code civil, créés par la loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages, le mariage d’un ressortissant français célébré à l’étranger n’était opposable aux tiers qu’à compter de la date de sa transcription et non de sa célébration. Le Tribunal a ainsi rappelé que l’administration fiscale constitue bien en l’espèce un tiers au sens de l’article 171-5 du code civil, la circonstance que le mariage soit opposable dès sa célébration aux époux et aux enfants étant sans incidence sur la date d’opposabilité, différente, aux tiers. En conséquence, l’administration fiscale pouvait légalement retenir la date de transcription du mariage sur les registres de l’état civil français pour la détermination du quotient familial du contribuable.
. Tribunal administratif de Limoges, 3 mars 2016, Société Sum’Art, n°1301596.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi de la requête d’une société ayant fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010, à l’issue de laquelle des rappels de cette imposition avaient été notifiés. Dans ses observations présentées à la suite de la proposition de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante avait présenté une demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, alors que l’impôt sur les sociétés n’avait pas fait l’objet de la proposition de rectification contestée. Dans ses observations, la société avait demandé le bénéfice du dispositif dit « de la cascade » en application des dispositions de l’article L. 77 du Livre des procédures fiscales.
Devant le tribunal administratif de Limoges, la société requérante faisait valoir que l’administration fiscale n’avait pas répondu dans les soixante jours, et devait donc être regardée comme ayant implicite accepté ses observations, concernant l’impôt sur les sociétés, en application des dispositions de l’article L. 57 A du Livre des procédures fiscales.
Le Tribunal a écarté ce moyen de procédure en estimant que le mécanisme d’acceptation implicite des observations du contribuable prévu par l’article L. 57 A du Livre des procédures fiscales ne pouvait s’appliquer qu’aux impositions faisant l’objet de la procédure de rectification et non à une imposition distincte. En l’espèce, l’imposition faisant l’objet de la vérification de comptabilité était la taxe sur la valeur ajoutée et non l’impôt sur les sociétés. Dans ces conditions, le Tribunal a estimé que le silence de l’administration pendant plus de soixante jours sur les observations de la société concernant l’impôt sur les sociétés, dès lors que les rectifications avaient porté sur la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait donc valoir acceptation implicite de ces observations, relatives à une imposition différente de l’imposition vérifiée. Le Tribunal a donc écarté ce moyen de procédure.
Etrangers.
. Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2016, M. D…..,n°1401294.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
. Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2016, M. D….,n°1400553.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Dans ces deux affaires, le tribunal administratif de Limoges était saisi, respectivement par un ressortissant marocain et par un ressortissant tunisien, de requêtes dirigées contre les rejets qui avaient été opposés aux demandes de regroupement familial qu’ils avaient présentées au bénéfice de membres de leur famille. Dans les deux cas, le préfet avait rejeté leur demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le montant des ressources mensuelles du demandeur était inférieur au minimum requis par ces dispositions. Dans les deux cas également, les requérants étaient titulaires de l’allocation adulte handicapé en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Dans une décision du 15 février 2016 (n°387977, aux tables du recueil), le Conseil d'Etat, saisi du cas d’un ressortissant algérien titulaire de l’allocation adulte handicapé en application des dispositions de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, a estimé que l’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Tribunal a rappelé que l’allocation adulte handicapé était versée, en application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, aux personnes qui remplissent un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la reconnaissance par la commission compétente d’une restriction substantielle et durable de leur accès à l’emploi, due à leur handicap En conséquence, le Tribunal a relevé que l’autorité compétente ne saurait, pour rejeter une demande de regroupement familial présentée par un étranger qui, du fait de son handicap, est titulaire de cette allocation, se fonder sur l’insuffisance de ses ressources, sans introduire, dans l’appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale, une discrimination à raison de son handicap prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lorsqu’il s’est également vu accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.
Le Tribunal a donc annulé les deux décisions de refus de regroupement familial qui étaient contestées devant lui.
Fonctionnaires et agents publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2016, M. D…..,n°1400204, 141347 et 151458.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Un infirmier employé par un centre hospitalier avait souhaité, à trois reprises en 2013, 2014 et 2015, participer à un mouvement national de grève. Néanmoins, les jours en cause, il était prévu qu’il devait être placé en repos hebdomadaire en application de l’article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 (année 2013), ou en journée de repos au titre de la réduction du temps de travail (années 2014 et 2015). Il a demandé au directeur du centre hospitalier de déplacer, en 2013 et 2012, ses jours de repos hebdomadaire et de repos au titre de la réduction du temps de travail et de le recenser comme gréviste, pour les jours en cause en 2012, 2013 et 2014. L’ensemble de ses demandes ayant été, explicitement ou implicitement, rejetées par le directeur du centre hospitalier, l’intéressé avait saisi le tribunal administratif de Limoges de requêtes dirigées contre ces décisions.
Le tribunal a estimé que les décisions contestées avaient un double objet : d’une part, refuser de recenser l’agent comme gréviste au motif qu’il se trouvait, aux dates des journées de grève nationale, soit en repos hebdomadaire, soit en journée de repos au titre de la réduction du temps de travail ; d’autre part, refuser de déplacer ces jours de repos. Le Tribunal a, en premier lieu, estimé que le refus de reconnaître un agent comme gréviste était nécessairement susceptible de porter atteinte à l’exercice du droit de grève par l’intéressé, ce qui excluait que la qualification en mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours (pour les critères des mesures d’ordre intérieur concernant les agents publics : Conseil d'Etat, Section, 25 septembre 2015, n°372624, au recueil).
Le Tribunal a, en second lieu, estimé que si l’agent était dispensé d’obligation de service en raison des modalités d’organisation du temps de travail, pendant les jours de repos hebdomadaire ou les journées de repos au titre de la réduction du temps de travail, cette situation ne faisait pas obstacle, en raison du caractère mensuel et forfaitaire du traitement des agents publics, à ce qu’il soit reconnu comme gréviste pendant ces jours de repos – à la différence des jours de congés annuels (Conseil d'Etat, 7 juillet 1978, n°03918 et Conseil d'Etat, 27 juin 2008, n°305350). Dès lors, le Tribunal a estimé que le directeur du centre hospitalier ne pouvait refuser de recenser comme gréviste l’agent au seul motif qu’il était, au cours des journées nationales de grève, dispensé d’obligation de service et a annulé, pour atteinte au droit de grève, ces décisions. En revanche, et dès lors que l’agent peut être considéré comme gréviste alors même qu’il est en jour de repos hebdomadaire ou de repos au titre de la réduction du temps de travail, l’exercice de son droit de grève n’implique pas le report ou la substitution des jours de repos. Le Tribunal a donc rejeté les conclusions du requérant en tant qu’elles étaient dirigées contre le refus de reporter ses jours de repos.
Marchés et contrats administratifs.
. Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, M. B … et Mme L…, n°1301436 et 1301441, C.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal a rejeté les conclusions tendant notamment l’annulation du marché public conclu entre l’Etablissement médico-social public (EMSP) de Saint-Junien (Haute-Vienne) et un exploitant d’une entreprise de transport de personnes, dont l’objet portait sur l’exercice, au titre de l’année scolaire 2013-2014, d’une activité de transport des enfants pris en charge par cet établissement. Ces conclusions avaient été présentées par deux autres exploitants d’une entreprise de transport de personnes qui avaient présenté chacun une candidature en vue de l’attribution d’une partie des lots du marché.
L’un des moyens d’annulation soulevés mettait en cause l’absence de vérification par l’EMSP de Saint-Junien de la détention de la licence de transport intérieur par l’attributaire du marché. Les requérants estimaient que la justification de cette détention devait être apportée par tout candidat.
La licence de transport intérieur est prévue par les dispositions de l’article L. 3411-1 du code des transports et de l’article 1-1 du décret du 16 août 1985 modifié, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Elle est délivrée aux entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes et qui doivent à cette fin être inscrites au registre tenu par le préfet de région.
Le tribunal a relevé qu’aucune disposition du code des marchés publics, ni aucune autre disposition, notamment du code des transports ou du décret du 16 août 1985, n’obligeait l’EMSP de Saint-Junien à imposer à chaque entreprise candidate de fournir, à l’appui de leur candidature, la justification de la détention de cette licence. Toutefois, le tribunal a relevé que cette absence d’obligation ne fermait pas toute possibilité de contrôle par le pouvoir adjudicateur. En effet, si celui-ci disposait d'informations susceptibles de faire naître un doute quant à la détention de la licence, il lui appartiendrait de vérifier que celle-ci ait bien été obtenue.
Nature et environnement.
. Tribunal administratif de Limoges, 28 janvier 2016, M. C…,n°1301027, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif de Limoges était saisi par un ensemble de requérants de conclusions tendant à l’annulation d’un arrêté préfectoral les mettant en demeure de retirer des remblais déposés sur une parcelle située sur le lit majeur d’une rivière. Selon l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/lit-majeur), le lit majeur d’un cours d’eau correspond au « lit maximum qu'occupe un cours d'eau dans lequel l'écoulement ne s'effectue que temporairement lors du débordement des eaux hors du lit mineur en période de très hautes eaux (en particulier lors de la plus grande crue historique). Ses limites externes sont déterminées par la plus grande crue historique. Le lit majeur du cours d'eau permet le stockage des eaux de crues débordantes ». L’article R. 214-1 du code de l’environnement soumet, en effet, à déclaration ou autorisation, selon la surface concernée, certains installations, ouvrages, ou remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau et cette formalité n’avait pas été accomplie en l’espèce.
Le Tribunal a estimé que, lorsque le préfet met en œuvre les pouvoirs qui lui sont confiés par l’article L. 216-1-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur jusqu’au 18 juillet 2013, aux termes duquel : « (…) Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités (…) », il était en situation de compétence liée, successivement pour mise en demeure de régulariser la situation (alinéa 1er de l’article L. 216-1-1 du code de l’environnement), puis d’ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation, en l’espèce des remblais (alinéa 2, cité ci-dessus, de l’article L. 216-1-1 du code de l’environnement). Cette situation de compétence liée entraîne donc l’inopérance d’un certain nombre de moyens soulevés par les requérants.
Comp, dans le cadre, non de la législation sur l’eau, mais de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement : l’ancien article L. 514-1 du code de l’environnement et Conseil d'Etat, 9 juillet 2007, n°288367, aux tables du recueil.
. Tribunal administratif de Limoges, 11 février 2016, M. A ..., n°1300852.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le requérant détenait, à son domicile, deux émeus, depuis septembre 2003, date à laquelle auraient éclos deux œufs qui lui avaient offerts en juillet. Sur la base d’informations reçues, il avait déposé une demande tendant à être autorisé à détenir ces animaux, mais sa demande avait été rejetée par une décision du préfet. Il avait saisi le tribunal administratif de Limoges d’une requête tendant à l’annulation de ce refus de détention.
Le refus d’autorisation de détention des émeus contesté était fondé sur la circonstance que le requérant n’était pas titulaire, contrairement aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques, du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques prévu par l’article L. 413-2 du code de l’environnement. Le requérant contestait l’applicabilité de l’arrêté du 10 août 2004, notamment au motif qu’il détenait les émeus depuis l’année 2003.
Le Tribunal a, en premier lieu, constaté que les émeus, de la famille des dromaiidés, figuraient bien dans la liste des animaux dont l’élevage était soumis aux dispositions des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement. En effet, l’article 1er de l’arrêté du 10 août 2004 incluait, dans la catégorie des élevages d’animaux d’espèces non domestiques, notamment, les élevages d’animaux ou espèces inscrits dans son annexe 2, laquelle renvoyait, à son tour, à une liste d’animaux ou espèces inscrits dans son annexe 3 et ne figurant pas dans son annexe 1, ce qui est le cas des dromaiidés. La détention d’émeus était donc bien soumise, en application de l’arrêté du 10 août 2004, aux conditions prévues par les articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement, et notamment à la détention du certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques.
Le Tribunal a, en second lieu, considéré que la circonstance que le requérant détenait les émeus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 août 2004, ne faisait pas obstacle à l’obligation de se conformer à cet arrêté dès lors, d’une part, que l’article L. 413-2 du code de l’environnement prévoyait expressément son applicabilité aux établissements préexistants et créés postérieurement au 14 juillet 1976, et d’autre part, que l’arrêté du 10 août 2004 n’aurait pu, sans méconnaître le principe d’égalité, prévoir un régime différent aux personnes déjà détentrices d’animaux d’espèces non domestiques.
Dès lors, le Tribunal a rejeté la requête qui était soumise à son examen.
Police.
. Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2016, Société New Atlantide, n°1400131.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal a fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par la société New Atlantide, tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2013 par laquelle le maire de la commune de Limoges l’a mise en demeure de « réaliser » une étude d’impact acoustique sur le fondement des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement. Cette société exploite sur le territoire de cette commune un club de sport, au sein duquel sont pratiquées des activités donnant lieu à la diffusion de musique.
Le moyen d’annulation est retenu est tiré de l’incompétence du maire de Limoges pour prendre cette mesure de police administrative. Les mesures prévues par les dispositions des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement, applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, se rattachent à un objectif de prévention des nuisances sonores. Le tribunal a estimé que ces dispositions, dont il a considéré qu’elles devaient être rapprochées de celles du I de l’article L. 171-8 du même code, instituaient un pouvoir de police administrative spéciale au profit du seul préfet de département.
Dès lors, le maire ne pouvait, ni sur le fondement de ses dispositions, ni sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale qu’il tient des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 et de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales en matière de tranquillité publique, prendre la mesure en litige, laquelle est spécifiquement prévue par les dispositions en cause du code de l’environnement, et répond à la même finalité tenant à la protection de la tranquillité publique. Le tribunal a implicitement relevé qu’une telle mesure ne pouvait, eu égard à sa nature, être justifiée par une situation de péril imminent, laquelle aurait pu ouvrir la possibilité d’une intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative générale.
Responsabilité de la puissance publique.
. Tribunal administratif de Limoges, 31 mars 2016, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, n°1300420.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif était saisi d’une requête indemnitaire du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) dirigée contre le centre hospitalier spécialisé Esquirol, agissant après avoir indemnisé les dommages subis par un agent de cet établissement public à la suite de son exposition professionnelle à l’amiante.
M. A, employé en qualité de maître ouvrier par ce centre hospitalier, a en effet été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions. Ce dernier, atteint d’un mésothéliome pleural, avait saisi le FIVA qui, dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, a formulé une première offre d’indemnisation. Après le décès de M. A, sa veuve, ses deux enfants et trois petits-enfants ont à nouveau saisi le fonds d’indemnisation, qui a formulé une seconde offre d’indemnisation.
Agissant par le biais de la subrogation instaurée par les dispositions de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA souhaitait obtenir de l’employeur de M. A le remboursement d’une partie des indemnités versées, correspondant aux préjudices moral, physique, d’agrément et esthétique subis par M. A et au préjudice moral de ses ayants droit, pour un montant total de 142 700 euros.
Pour obtenir réparation, le FIVA se plaçait sur le terrain des principes dégagés pour la première fois dans l’arrêt Mme M. du Conseil d’Etat (4 juillet 2003, n° 211106, classé A), qui permet au fonctionnaire victime d'un accident de service qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux non réparés par sa pension d’invalidité ou des préjudices personnels, d’obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Le tribunal a, à cette occasion, rappelé que ce principe était applicable à la fonction publique hospitalière et permettait également aux ayants droit de la victime d’obtenir réparation de leur préjudice moral.
Le centre hospitalier Esquirol soutenait que la procédure devant le FIVA méconnait le droit à un procès équitable consacré par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’avait eu aucune possibilité de discuter des sommes que ce fonds a allouées aux consorts A avant leur versement.
Le tribunal a cependant écarté cette argumentation dans la mesure où il était loisible au centre hospitalier de présenter toute contestation utile en la matière dans la présente instance, dans la mesure où, s’il ne peut les majorer, le juge administratif n’est pour autant pas lié par le montant des sommes versées par le FIVA au stade du recours subrogatoire.
En l’espèce, le centre hospitalier Esquirol ne contestant pas l’imputabilité au service de l’affection de M. A et ne remettant pas sérieusement en cause le montant des sommes versées par le FIVA, le tribunal l’a condamné à verser au FIVA la somme de 142 700 euros demandée.
Enfin, le centre hospitalier Esquirol formait un appel en garantie afin que l’Etat le relève indemne de sa condamnation. L’établissement public estimait en effet que la présence d’amiante dans son établissement résultait du respect du cadre législatif fixé pour la construction de ses bâtiments. Cet appel en garantie a cependant été rejeté dans la mesure où le centre hospitalier n’apportait aucun élément au soutien de ses dires.
Travail et emploi.
. Tribunal administratif de Limoges, 10 mars 2016, Mutualité française Limousine, n°1300633.
Président-rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
La Mutualité française limousine a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. B., salarié protégé. L’inspecteur du travail a refusé cette autorisation au motif, d’une part, que l’employeur n’avait pas respecté le délai minimal de convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail et, d’autre part, que la réalité des faits reprochés au salarié n’était pas établie et que la demande de licenciement était liée aux mandats représentatifs détenus par le salarié. Sur recours hiérarchique de l’employeur, le ministre chargé du travail, sans se prononcer sur les faits reprochés ni sur le lien entre le licenciement et les mandats du salarié, a confirmé ce refus en considérant que l’administration du travail est tenue de refuser une autorisation de licenciement lorsque l’employeur a méconnu une formalité substantielle telle que le délai minimal de convocation à l’entretien préalable au licenciement. Le tribunal a alors été saisi par l’employeur d’un recours en annulation dirigé contre les décisions de l’inspecteur du travail et du ministre.
Le tribunal a jugé que pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 1232-2 du code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre et que le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, le jour de remise de la lettre ne comptant pas pour la détermination de ce délai, non plus que le dimanche et les jours fériés. Dans cette affaire, le salarié avait pu se rendre à l’entretien, mais la lettre de convocation lui avait été remise le samedi 8 septembre 2012, en vue d’un entretien fixé au vendredi 14 septembre suivant, soit seulement quatre jours ouvrables après. La juridiction a donc estimé que le salarié n’avait pas bénéficié du temps suffisant pour préparer cet entretien et que, pour ce seul motif, l’administration était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l’employeur. Elle a, par conséquent, rejeté la requête sans examiner les autres moyens qui n’étaient pas en rapport avec cette garantie du délai de convocation. Le tribunal administratif d’Amiens (30 avril 2013 Mme G. n° 1103469) a précédemment rendu un jugement dans le même sens.
Travaux publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 7 avril 2016, Mme…., n°1400516, C.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Par un jugement du 7 avril 2016, le tribunal a condamné la communauté d’agglomération de Limoges Métropole (CALM) à verser une indemnité à la victime d’un accident survenu le 28 mars 2011 rue des Arènes à Limoges. Il l’a également condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne les dépenses de santé qu’elle a exposées au profit de Mme….
L’accident est survenu le lundi 28 mars 2011, alors que la victime circulait à pied sur un trottoir dont une portion de revêtement avait été enlevée pour l’exécution de travaux de réparation d’un câble électrique souterrain réalisés pour le compte de la société Electricité réseau distribution France (ERDF). La chute est intervenue à l’endroit où le revêtement du trottoir n’avait pas été reconstitué et où apparaissait sur le sol une plaque en ciment qui n’avait pas été scellée.
Le tribunal n’a pas retenu, dans l’examen des conclusions de la requérante, l’argument de la CALM qui estimait que le dommage ne lui était pas imputable dans la mesure où les travaux sur la voie publique n’avaient pas été exécutés non pour son propre compte et que l’accident avait eu lieu le lendemain matin du jour de l’expiration de la permission de voirie que l’établissement public avait, pour la réalisation de ces travaux, délivré à la société ERDF.
Le tribunal a en effet estimé que la CALM ne pouvait pas se retrancher derrière la courte période écoulée entre ce jour et le moment auquel s’est produit l’accident pour invoquer son absence d’information quant à l’état du trottoir à cet instant-là. Il lui incombait en effet, en sa qualité d’autorité gestionnaire de la voie publique en cause, de vérifier au jour de l’expiration de cette autorisation ou, en cas d’impossibilité, dans les jours qui la précédaient, si les conditions de circulation sur ce trottoir pouvaient présenter un danger et, le cas échéant, soit y remédier, soit, à tout le moins, en signaler l’existence par une information appropriée. Aucune disposition n’ayant été prise par la CALM, sa responsabilité pour défaut d’entretien normal de la voie publique a été engagée à l’égard de la victime usagère de la voie en cause. Le tribunal a toutefois exonéré pour moitié la CALM de sa responsabilité en retenant une faute d’imprudence de la victime dès lors que la plaque en ciment non scellée était visible.
Enfin, statuant sur l’appel en garantie formé contre la société ERDF, le tribunal a condamné cette société à garantir la CALM à hauteur de 80% des sommes à verser à la victime. Cette société a commis une faute en ne s’assurant pas que l’entreprise ayant réalisé les travaux les avait achevés au jour d’expiration de la permission de voirie et en ne vérifiant pas en particulier que la circulation sur le trottoir de la rue des Arènes ne présentait aucun danger sur la portion concernée par ces travaux.
Jurisprudence du 1er septembre au 31 décembre 2015.
Etrangers.
. tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, M. …., n°1500797.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif était saisi d’une requête dirigée contre un arrêté préfectoral refusant d’admettre M…, ressortissant guinéen, au séjour et assortissant ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le préfet avait, eu égard à l’épidémie du virus Ebola sévissant en Guinée, indiqué, dans le dispositif de l’arrêté, que l’intéressé était obligé de quitter le territoire français dès que les conditions sanitaires dans son pays d’origine le permettraient et qu’il serait reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il est légalement admissible « quand l’épidémie d’Ebola en Guinée sera déclarée sous contrôle ou éradiquée ».
Le Tribunal, saisi à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire d’un moyen tiré d’une erreur de droit, a estimé que le préfet avait bien souhaité accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Néanmoins, il a considéré qu’en ne déterminant pas de manière précise la durée du délai de départ accordé à l’intéressé, l’administration n’avait pas réellement permis au requérant de pouvoir organiser son départ volontaire du territoire français. Le Tribunal a donc estimé que le préfet avait méconnu l’article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne déterminant pas le délai de départ volontaire laissé à l’étranger et a annulé, en conséquence, la seule décision relative au délai de départ volontaire.
. tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, M. …., n°1500773.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal administratif était saisi d’une requête dirigée contre un arrêté préfectoral refusant de délivrer, pour la deuxième fois, à un ressortissant étranger une carte de séjour temporaire mention « étranger », et assortissant ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Le Tribunal administratif a annulé le refus de séjour, et par voie de conséquence, la mesure d’éloignement après avoir estimé que le préfet avait commis une erreur d'appréciation en estimant que les études suivies par l’intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, condition exigée par la jurisprudence de la juridiction administrative pour le renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant ».
Le Tribunal était, également, saisi de conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Le juge, saisi de conclusions à fin d’injonction, doit prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date du jugement prescrivant la mesure d’exécution (Conseil d'Etat, avis, Section, 30 novembre 1998, n°188350, au recueil). Néanmoins, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge enjoigne la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour une période révolue. En particulier, le renouvellement d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » étant conditionné par l’appréciation de la réalité et du sérieux des études au titre d’une année déterminée, l’injonction de délivrer le titre de séjour concerne l’année universitaire au titre de laquelle le refus de séjour annulé a été refusé, et non l’année universitaire au cours de laquelle le tribunal se prononce.
Ce faisant, le tribunal administratif a appliqué les principes dégagés par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt, de plénière, du 27 octobre 1998 (n°97PA00391, inédite au recueil), dans lequel la cour administrative d'appel a estimé que la circonstance que l’année universitaire pour laquelle le requérant avait sollicité une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant était révolue ne privait pas d’objet des conclusions à fin d’injonction, dès lors que la délivrance d'un tel titre, modifiant, fût-ce rétroactivement, la situation de droit de l'étranger à qui elle a été illégalement refusée, est susceptible de produire des effets quant à l'appréciation par l'administration de la situation ultérieure de l'intéressé dans le cadre soit de l'ordonnance du 2 novembre 1945 – alors applicable – soit de procédures de régularisation.
. tribunal administratif de Limoges, 13 octobre 2015, M…. , n°1501622.
Magistrat désigné : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif était saisi d’une requête dirigée contre un arrêté préfectoral portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et fixation du pays de renvoi. Le requérant ayant été assigné à résidence, par un arrêté du même jour, les conclusions dirigées, notamment, contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays relevaient de la compétence du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges.
Le tribunal administratif a annulé, en l’espèce, la seule décision refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français, en estimant que cette décision était entachée d’erreur manifeste d'appréciation. En effet, le maire de la commune dans laquelle le requérant entendait se marier avait saisi le Procureur de la République en application de l’article 175-2 du code civil. A la date de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, le Procureur de la République n’avait pas encore rendu sa décision, au terme de laquelle il lui appartient de statuer sur la possibilité de célébrer ou non le mariage au vu des résultats de l’enquête, alors que cette procédure constitue une garantie substantielle de la liberté du mariage. Le Tribunal a considéré dès lors, qu’en obligeant le ressortissant étranger, qui souhaitait épouser une ressortissante française, à quitter le territoire français avant l’aboutissement de la procédure devant le Procureur de la République, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Cette position avait été adoptée, en matière de reconduite à la frontière, par plusieurs jugements du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2005, n°0504254 ; du 20 avril 2005, n°0502538, et du 21 février 2005, n°0501063.
. Tribunal administratif de Limoges, 29 octobre 2015, M. C… , n°1501173
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
M. C…, ressortissant azerbaïdjanais, s’est vu opposer, par le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 14 avril 2014, un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Le tribunal administratif de Limoges a, par jugement du 16 octobre 2014, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Faisant suite à l’injonction précitée et à une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l’intéressé par courrier du 14 juillet 2014, le préfet de la Haute-Vienne, par arrêté du 16 mars 2015, a une nouvelle fois refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé s’il ne satisfaisait pas à cette obligation.
A l’appui de son recours contentieux, M. C… invoquait notamment la violation, par le préfet, de l’autorité de la chose jugée en se prévalant du caractère définitif du jugement du 16 octobre 2014. Il estimait ainsi que le préfet ne pouvait pas lui refuser le séjour et devait nécessairement lui délivrer le titre de séjour que le Tribunal lui avait, selon lui, enjoint de délivrer.
Le Tribunal a tout d’abord rappelé que la demande de titre de séjour dont avait été initialement saisi le préfet était fondée sur le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile c’est-à-dire sur les dispositions permettant la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire en raison de l’état de santé d’un étranger. Le Tribunal a ensuite constaté que M. C… avait, entre temps, sollicité du préfet la délivrance d’un titre de séjour fondé non plus sur son état de santé, demande qu’il avait abandonnée, mais en sa qualité de « salarié » ou de « travailleur temporaire » en invoquant explicitement l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le Tribunal a donc considéré que, à la date à laquelle le préfet avait pris son deuxième arrêté, soit le 16 mars 2015, il était exclusivement saisi d’une demande de séjour au titre d’une activité salariée ou de travailleur temporaire. Dès lors, le Tribunal a implicitement considéré qu’il y avait eu un changement dans les circonstances de fait concernant M. C… et que le préfet n’était légalement plus, pour ce motif, tenu par l’injonction que le Tribunal lui avait faite dans son jugement du 16 octobre 2014 puisque, dans ce jugement, le Tribunal se prononçait sur un refus de séjour en tant qu’étranger malade uniquement. Il n’a donc, au final, retenu aucune méconnaissance par le préfet de l’autorité de la chose jugée.
. Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2015, Mme C…., n°1501294, C+.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Mme C..., ressortissante algérienne, s’est vue opposer, par le préfet de la Haute-Vienne, le 23 avril 2015, un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Elle avait demandé la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes duquel : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ″vie privée et familiale″ est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour l’instruction de la demande, le préfet avait saisi pour avis le médecin de l’agence régionale de santé du Limousin. Cette obligation de consultation est prévue par les dispositions du 11° de l’article L 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la mesure où il s’agit d’une règle de procédure, cette obligation de consultation est opposable à l’administration lorsqu’elle instruit une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Mme C... invoquait l’irrégularité de l’avis du médecin de l’agence régionale de santé du Limousin au motif que si ce dernier avait pris position sur l’existence d’un traitement approprié en Algérie, il n’avait pas donné son avis sur l’accessibilité de ce traitement dans ce pays. Dans son jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal a estimé que l’avis du médecin de l’agence régionale de santé n’avait pas à porter sur ce dernier point. Il a en effet considéré que l’appréciation sur l’accessibilité des soins existants repose sur des considérations qui ne sont pas en lien avec des éléments d’ordre médical, mais avec des données telles que, d’une part, le coût du traitement ou l’absence de modes de prise en charge adaptés, d’autre part, des circonstances tirées des particularités de la situation personnelle du demandeur qui l’empêcheraient d’y accéder effectivement, par exemple une distance très importante entre le domicile du patient et le centre de soins.
Ainsi, la circonstance que l’avis du médecin de l’agence régionale de santé du Limousin n’ait pas porté sur l’accessibilité du traitement approprié à l’état de santé de la requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure et par suite sur la légalité du refus de séjour.
.Tribunal administratif de Limoges, 31 décembre 2015, Mme A… , n°1501582
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
Mme A…, ressortissante guinéenne, s’est vu opposer, par le préfet de la Haute-Vienne, le 29 juillet 2015, un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à défaut de satisfaire à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français.
A l’appui de ses conclusions en annulation de la décision fixant comme pays de destination la Guinée, Mme A…, qui a notamment deux filles mineures, invoquait la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en faisant valoir le risque d’excision pour ses deux filles en cas de retour en Guinée. Le respect de telles stipulations suppose que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative accorde une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Au cas présent, le Tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination après avoir considéré comme établis les risques d’excision allégués. Pour ce faire, il s’est notamment appuyé sur le fait que Mme A… avait elle-même été victime d’excision en Guinée avant de fuir pour la France et que la prévalence de l’excision en Guinée était, selon un rapport public du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) de juillet 2013 qui, en outre, qualifie cette pratique de « quasi universelle » dans ce pays, de 96%.
Fonctionnaires et agents publics.
. tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2015, M….., n°1400020 et 1400158.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le requérant avait fait l’objet d’une sanction de mise à la retraite d’office en mai 2011. Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges avait, en août 2011, ordonné la suspension de l’exécution de la mise à la retraite d’office, dans l’attente de la décision au fond du Tribunal. En exécution de cette ordonnance, l’administration avait versé à nouveau ses traitements à l’intéressé. Saisie de conclusions à fin d’annulation de la sanction, la formation collégiale du tribunal administratif de Limoges avait, en revanche, rejeté ces conclusions par un jugement de février 2012. Dès lors, l’administration avait, en novembre 2013, adopté une mesure rétroactive en admettant le requérant au bénéfice des allocations chômage à compter de la sanction initiale de mai 2011. Un titre de perception avait également été émis portant sur la restitution par l’ancien agent des traitements perçus entre mai 2011 et février 2012, date du jugement au fond. Le requérant avait, de nouveau, saisi le tribunal administratif de Limoges de deux requêtes dirigées contre la décision d’admission rétroactive au bénéfice des allocations chômage et du titre de perception.
Deux questions principales se posaient au tribunal administratif.
En premier lieu, le requérant contestait, notamment, le caractère rétroactif de son admission au bénéfice des allocations chômage, prononcée en novembre 2013 à compter de mai 2011. Le tribunal administratif a estimé que cette rétroactivité n’était pas illégale dès lors, d’une part, que les mesures prises par l’administration en application de l’ordonnance du juge des référés ne pouvaient avoir qu’un caractère provisoire (Conseil d'Etat, 26 novembre 2003, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, n°259120, aux tables du recueil, et Conseil d'Etat, 11 août 2005, n°281486, aux tables du recueil), et d’autre part, que l’administration peut déroger à la règle générale, selon laquelle les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, lorsqu’il s’agit de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la carrière des fonctionnaires ou des militaires ou pour procéder à la régularisation de leur situation (Conseil d'Etat, 17 mars 2004, n°225426, aux tables du recueil).
En second lieu, le tribunal administratif a estimé que le requérant ne pouvait contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre de perception dès lors que l’administration avait déclaré l’agent redevable de la somme due au titre des traitements perçus entre mai 2011 et février 2012 par une décision de septembre 2012, décision individuelle qui présentait un caractère définitif. Le tribunal administratif a donc considéré qu’en raison du caractère définitif de cette décision, le requérant ne pouvait invoquer, par voie d’exception, à l’encontre du titre de perception, l’illégalité de la décision individuelle par laquelle l’autorité administrative déclare la personne redevable (Conseil d'Etat, 26 novembre 1986, centre hospitalier de Fougères, n°42196, inédite au recueil).
. tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, M. …., n°1400124, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi de la requête d’un sous-officier de gendarmerie dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense l’avait radié des cadres de la gendarmerie nationale pour motif disciplinaire.
Le requérant invoquait la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-41 du code de la défense, qui prévoient que la radiation des cadre des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l’intérieur. En l’espèce, d’une part, le signataire de la décision contestée, major général de la Gendarmerie, avait compétence pour signer au nom du ministre de la défense et par délégation, les décisions relevant de la compétence du ministre en matière disciplinaire, en application des dispositions combinées de l’article D. 3122-5 du code de la défense, et de l’article 2 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale. D’autre part, ce même major général de la Gendarmerie avait compétence pour assurer, par délégation cette fois du ministre de l’intérieur, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de la gendarmerie nationale, la direction générale du service, chargée notamment de la discipline du personnel militaire de la gendarmerie, en application des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, des articles D. 3122-1, D. 3122-5 du code de la défense et de l’article 2 de l’arrêté du 12 août 2013. Dès lors, le major général de la Gendarmerie nationale était compétent, à la fois, pour prendre la décision au nom du ministre de la défense et pour rendre, au nom du ministre de l’intérieur, l’avis prévu par l’article R. 4137-41 du code de la défense.
Eu égard à ce dispositif très spécifique mis en place pour la combinaison de ces dispositions, et de cette double compétence du signataire de la décision, le Tribunal a estimé que même si l’avis du ministre de l’intérieur n’avait pas été formellement rendu conformément à l’article R. 4137-41 du code de la défense, ce vice de procédure n’avait pas exercé une influence sur le sens de la décision contestée, ni n’avait privé le requérant d’une garantie, ni n’avait affecté la compétence de l’auteur de l’acte (Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, n°335033 et 335477).
Marchés et contrats administratifs.
. tribunal administratif de Limoges, 17 septembre 2015, Société FMAU, n°130047, C+.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
La Communauté d’agglomération de Brive a, en 2012, conclu, sur le fondement du code des marchés publics, un contrat ayant pour objet la maitrise d’œuvre d’un projet de création d’une zone d’aménagement concerté s’étendant sur une partie de l’emprise de l’ancien aérodrome de Brive-Laroche. Le contrat a été conclu avec un groupement, composé de quatre sociétés.
Un autre groupement était candidat à l’attribution de ce contrat. L’une des sociétés qui était membre de ce groupement conjoint, et qui en était également le mandataire, a saisi le Tribunal d’un recours tendant à l’annulation du contrat et à la condamnation de la Communauté d’agglomération de Brive à réparer les préjudices nés de l’éviction du groupement. La requête, signée par un avocat, a été présentée par ladite société en qualité de mandataire du groupement.
Toutefois, le Tribunal a considéré que la société ne pouvait pas se présenter en cette qualité. Il a pris en compte la particularité de la structure juridique que constitue un groupement. En effet, un groupement ne dispose pas de la personnalité juridique. Il n’est formé que pour les besoins de la conclusion et, le cas échéant, de l’exécution d’un marché public. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête, le groupement, évincé au cours de la passation du contrat en cause, n’avait plus d’existence juridique. Aussi, le Tribunal a estimé que la société ayant présenté le recours devait être en réalité regardée comme agissant, d’une part, en son nom propre et en qualité de membre du groupement, d’autre part, en qualité de mandataire des autres sociétés ayant formé ce même groupement.
Le Tribunal a alors fait application de la jurisprudence selon de laquelle dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes, en revanche, les conclusions propres à chaque requérant, telles que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne sauraient être accueillies sans que les fins de non-recevoir opposées aient été écartées – CE, 27 juillet 2005, Commune de Sanary-sur-Mer, n° 278266.
Il a ainsi admis la recevabilité de la société en tant qu’elle agissait en son nom propre pour demander l’annulation du contrat. Après avoir annulé ce contrat, le Tribunal a statué sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a nié la recevabilité de la société ayant présenté le recours à agir au nom des autres sociétés. En effet, ces dernières avaient chacune donné mandat à la première pour les représenter en justice, mandat qui incluait le choix de l’avocat. Or, pour être recevables à présenter des conclusions propres, il aurait fallu qu’elles saisissent elles-mêmes le tribunal ou qu’elles mandatent elles-mêmes un avocat.
. Tribunal administratif de Limoges, 26 novembre 2015, Préfet de la Région Limousin, n°1301275, C+.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Pour la réalisation des travaux de restauration extérieure de l’église Notre-Dame, située sur le territoire de la commune de Saint-Quentin-la-Chabanne (Creuse) et classée monument historique, l’Etat, maître d’ouvrage, a conclu deux contrats de marché public, l’un avec la société Blanchon, chargée de procéder à la réfection de la toiture de cette église, l’autre avec un architecte, chargé de la maîtrise d’œuvre. Pour l’exécution de ce marché, la société Blanchon a posé les tuiles qu’elle avait acquises auprès de la société Melin Trialis matériaux, laquelle les avait achetées à leur fabricant, la société Terreal.
A la suite de désordres affectant la toiture de l’église, le préfet de la région Limousin a, au nom de l’Etat, recherché devant le Tribunal administratif de Limoges la responsabilité « in solidum » notamment de ces trois sociétés, sur le fondement de la garantie décennale. L’intérêt de l’affaire porte sur le règlement de la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur les conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la société Terreal.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que lorsque le juge administratif est saisi, par un maître d’ouvrage, de conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la responsabilité décennale, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître celles de ses conclusions qui sont dirigées contre une personne qui n’avait pas la qualité de participant à l’exécution de ces travaux publics – TC, 24 juillet 1997, Société De Castro, n° 3060, p. 540 ; TC, 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyd's de Londres, n° 3621, p 555.
Un simple fabricant n’est généralement pas un participant à l’exécution de travaux publics. Mais il en va différemment pour les personnes qui peuvent être regardées comme ayant la qualité de fabricant au sens du premier alinéa de l’article 1792-4 du code civil. Selon les dispositions de cet alinéa : « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (…) ».
Il découle de ces dispositions que dès lors que le juge administratif est compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre le « locateur d'ouvrage », il est également compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la personne ayant « fabriqué » un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance – CE, 21 octobre 2015, Commune de Tracy-sur-Loire, n° 385779, tables.
En l’espèce, si la société Terreal avait « fabriqué » les tuiles posées par la société Blanchon, le tribunal a estimé qu’elle n’avait pas la qualité de « fabricant » au sens des dispositions du premier alinéa de l’article 1792-4 du code civil. En effet, les tuiles ne constituent ni un ouvrage, ni une partie d’ouvrage, ni un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance au sens de ces mêmes dispositions – cf. CE, 20 mars 1992, Société Tuileries de Perrignier, n° 97819, Recueil Lebon. La seule circonstance que ces tuiles ont été posées sur un bâtiment classé « monument historique » a été considérée par le tribunal comme sans incidence sur ce point.
Les conclusions dirigées contre la société Terreal ont dès lors été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Nature et environnement.
. tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2015, M. et Mme …., n°1300447.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-7 du code de l’environnement, L. 151-36 et L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime qu’une commune peut exécuter des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, ce caractère d’intérêt général ou d’urgence étant prononcé par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.
Par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne pris le 16 janvier 2013 sur le fondement de ces dispositions, ont été déclarés d’intérêt général, à la demande de la commune de Javerdat, les travaux de rétablissement des écoulements des eaux de ruissellement au sein du village de Pic, situé sur son territoire et ont été instituées les servitudes nécessaires à leur réalisation. M. et Mme …., propriétaires d’une des parcelles concernées par ces travaux ont saisi le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté.
Le tribunal a annulé cet arrêté en retenant le moyen tiré de l’absence d’organisation d’une enquête publique préalable au prononcé de la déclaration d'intérêt général. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-7 et R. 214-89 du code de l’environnement, ainsi que de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime que, sauf lorsque les travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, ou n'entraînent aucune expropriation et sauf lorsque le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées, la déclaration d'intérêt général doit être précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l’environnement.
En l’espèce, le débat portait sur l’existence d’une situation de péril imminent, invoquée par la commune et le préfet pour justifier l’absence d’organisation d’une enquête publique. L’exécution des travaux en cause a été justifiée par « la situation de péril imminent provoqué par la stagnation des eaux de ruissellement sur la chaussée traversant le village du Pic, aggravé par le risque de gel ». Selon le préfet de la Haute-Vienne et la commune de Javerdat, l’existence d’une situation de péril imminent était justifiée par les difficultés de circulation pour les habitants, en période d’intempéries et de gel, pouvant générer des risques de chute.
Le tribunal a estimé que ces éléments ne permettaient pas de caractériser l’existence d’une situation de péril imminent. Il s’est appuyé en particulier sur les travaux préparatoires à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dont sont issues les dispositions instituant la dispense d’enquête publique. Il ressort notamment de ces travaux préparatoires que la notion de péril imminent renvoie à un danger grave mettant en cause la sécurité publique, tel qu’une rupture de digue ou une pollution accidentelle.
Aussi, le tribunal a considéré que l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne pris le 16 janvier 2013 était entaché d’un vice de procédure constitutif, en l’espèce, d’une illégalité.
Responsabilité de la puissance publique.
. tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2015, M. …n°1300224, C+.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
M. …, agent commercial, a, en 1996, conclu, avec une société, un contrat d’agent commercial, plusieurs fois renouvelé. En vertu de ce contrat, M. …. s’est trouvé mandaté aux fins de représentation et de vente, au nom et pour le compte de cette société, les produits fabriqués par la société. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par un jugement du 29 mars 2012 du tribunal de commerce de Périgueux. Cette mesure a été décidée après que, par un jugement du même jour, le même tribunal avait, d’une part, arrêté le plan de cession à un repreneur de l’entreprise exploitée, et, d’autre part, en application des dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce, déterminé les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité reprise, emportant la cession au repreneur des contrats mentionnés dans le jugement.
Le tribunal administratif de Limoges a été saisi par M. …., d’un recours tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des lois. Deux fondements de responsabilité étaient invoqués : 1) La responsabilité du fait des lois, fondée sur la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; 2) La responsabilité du fait d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
L’action en responsabilité de M. … contre l’Etat a pour origine l’absence de mention dans le premier jugement du 29 mars 2012 de son contrat d’agent commercial. Cette absence a fait obstacle à la cession de ce contrat au repreneur de la société. M. … estime que cette responsabilité est engagée en raison de deux séries de dispositions législatives : celles de l’article L. 642-7 du code de commerce qui fixent les catégories de contrats pouvant être cédés, sous certaines conditions, au repreneur (1) ; et celles des articles L. 661-6 et L. 661-7 de ce code qui encadrent l’exercice des voies de recours contre un jugement déterminant les contrats cédés (2).
1) Les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce ont été rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le tribunal a en effet estimé que le dommage subi par M. …. ne procédait pas directement de la loi puisque son contrat n’était pas exclu du champ des contrats qui y étaient expressément mentionnés, mais de la mise en œuvre de ces dispositions législatives. Or cette mise en œuvre découlait, non pas d’une décision administrative, ce qui aurait permis d’asseoir la compétence de la juridiction administrative, mais d’une décision juridictionnelle d’une juridiction judiciaire - cf. Considérants 2 à 6.
2) Les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait des dispositions des articles L. 661-6 et L. 661-7 du code civil ont été rejetées au fond. Il résulte de ces dispositions qu’un cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, mais dont le contrat n’a pas été cédé en vertu d’un jugement validant un plan de cession d’une entreprise, ne peut exercer aucune voie de recours contre ce jugement. M. …. soutenait avoir été dépossédé d’un élément de son patrimoine que constituait, selon lui, la clientèle qu’il avait apportée à la société. Il s’est toutefois borné à invoquer la méconnaissance, par les dispositions des articles L. 661-6 et L. 661-7 du code civil, des stipulations combinées de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 13 de cette convention, dont il résulte que toute personne physique a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale lorsqu’elle estime qu’elle a été privée de la propriété d’un bien. Le tribunal a estimé que M. …, simple mandataire de la société dans le cadre du contrat d’agent commercial, n’était pas propriétaire de cette clientèle et ne pouvait dès lors invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole - cf. Considérants 7 à 11.
. Tribunal administratif de Limoges, 12 novembre 2015, Mme G …, n° 1301658 et 1401095 C+
Président- rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal administratif était saisi d’une demande indemnitaire par un automobiliste qui, alors qu’il circulait sur une route départementale, était entré en collision avec un véhicule arrivant sur sa droite par une voie communale prioritaire.
Le tribunal a estimé que l’accident était imputable au département de la Corrèze, dès lors que l’intersection, située dans un virage, n’était visible que sept mètres avant, et que sa présence n’était pas signalée pour les usagers de la route départementale.
Le contrat d’assurance du requérant n’était plus valide au jour de l’accident. Le tribunal a relevé que cette absence d’assurance pouvait, le cas échéant, justifier l’application des sanctions prévues à l’article L. 324-2 du code de la route et faisait obstacle à ce que l’assureur indemnise les victimes de l’accident et exerce ensuite à l’encontre de la personne publique responsable l’action subrogatoire prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances. Mais il a jugé que cette infraction n’affectait pas, par elle-même, la capacité de l’automobiliste à conduire un véhicule et qu’elle n’était donc pas à l’origine des dégâts dus à l’accident. Il en a déduit que cette absence d’assurance ne constituait pas une faute de la victime et était donc sans influence sur le droit à indemnisation de l’intéressé.
La demande indemnitaire a cependant été rejetée faute d’éléments démontrant la réalité du préjudice invoqué.
. Tribunal administratif de Limoges, 26 novembre 2015, Mme C… n°1401286.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Labouysse.
Rapporteur public : M. Debrion.
Par un arrêté du 30 juin 2004, le président de la communauté de communes du bassin d’Objat a, en vue de la réalisation d’un projet de création d’une voie publique, décidé de l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’acquisition de parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. L’une de ces parcelles, appartenant à Mme C, avait donné lieu à la conclusion d’un compromis de vente, auquel il n’a pas été donné suite compte tenu de l’existence de ce projet de création d’une voie publique. L’enquête publique préalable s’est achevée le 9 août 2004 et un rapport, favorable au projet, a été établi par le commissaire-enquêteur le 12 août 2004. Toutefois, aucune déclaration d’utilité publique n’est intervenue à la suite de cette enquête publique, la communauté de communes du bassin d’Objat ayant renoncé à son projet.
Mme C... a recherché devant le Tribunal la responsabilité de la puissance publique, notamment de la communauté de communes du bassin d’Objat. Elle demandait à être indemnisée d’une perte de valeur vénale de la parcelle en cause dont la vente n’avait pu être réalisée.
Il résulte des dispositions alors applicables du I de l’article L. 11-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que l’acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable lorsqu’il doit être pris, comme en l’espèce, par le préfet de département et qu’en l’absence d’un tel acte, la collectivité est réputée avoir renoncé au projet soumis à enquête publique préalable. Le tribunal a alors rappelé que si en proposant de faire usage du droit d'expropriation puis en renonçant à le faire, la collectivité expropriante ne commet aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers le propriétaire des parcelles concernées par la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ce propriétaire peut rechercher la réparation du préjudice particulier qu'il a pu subir, dans un intérêt général et qui, en raison de son caractère spécial et de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Le tribunal a estimé que le préjudice dont Mme C... demandait réparation ne pouvait pas être indemnisé dans ce cadre. En effet, Mme C... n’a pas cédé son bien postérieurement à la renonciation, alors qu’elle aurait pu décider de mettre de nouveau en vente son bien postérieurement à la décision de renonciation. Elle se bornait à invoquer une perte de valeur vénale par rapport à une vente qui serait susceptible d’être réalisée un jour.
Jurisprudence du 1er mai 2015 au 31 août 2015
Collectivités territoriales.
. Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2015, M. C., n° 1301400
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal était saisi d’un recours en annulation contre une décision par laquelle le maire d’une commune avait rejeté la demande d’un conseiller municipal tendant à ce qu’il soit mis à la disposition du groupe politique distinct de la majorité municipale auquel il appartenait un espace de communication politique dans le cadre d’une exposition organisée dans la commune portant notamment sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.
Selon l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ».
Le tribunal a considéré, en se fondant sur les dispositions précitées, que toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal devait être regardée, quelle que soit la forme retenue, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale.
Il en a déduit que l’exposition organisée par la commune, compte tenu notamment de son objet, constituait bien une forme de diffusion d’un bulletin d’information générale, et que, par suite, il convenait de réserver un espace d’expression aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale.
Faisant application de ces principes, le tribunal a estimé, en l’espèce, qu’aucun espace d’expression n’avait été accordé dans le cadre de l’exposition précitée au groupe politique distinct de la majorité municipale auquel appartenait le requérant.
Par suite, il a jugé que le maire de la commune avait méconnu les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et il a donc annulé la décision litigieuse.
Contributions et taxes.
. Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2015, SARL T., n° 1300235
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
Une société exerçant l’activité commerciale principale de fabrication et vente d’articles de voyage et de maroquinerie demandait au tribunal de prononcer la restitution de deux crédits d’impôt à raison de dépenses de prospection commerciale exposées dans le cadre d’exportations.
Selon l’article 244 quater H du code général des impôts, l’obtention d’un tel crédit d’impôt est subordonnée notamment au recrutement, par l’entreprise, d’une personne affectée au développement des exportations. Le tribunal a considéré que le recrutement d’une personne par l’entreprise supposait l’existence, entre les deux parties, d’un lien de subordination au sens du code du travail.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le tribunal a estimé qu’aucun lien de subordination n’existait entre la société requérante et la personne qu’elle avait chargée de développer les exportations, cette personne étant en réalité un agent ayant la qualité de commerçant indépendant.
Par conséquent, la juridiction a considéré que les conditions prévues à l’article 244 quater H du code général des impôts n’étaient pas remplies et que la société requérante ne pouvait alors pas prétendre à la restitution de crédits d’impôt.
La requête a donc été rejetée.
Etrangers.
. Tribunal administratif de Limoges, 2 juillet 2015, M. A.B.…., n°1300764.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Houssais.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Dans cette affaire, et d’autres, le tribunal administratif était saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le préfet, saisi d’une demande d’un étranger tendant au bénéfice du statut de réfugié, après que lui a été refusée la qualité de demandeur d’asile, prononce sa réadmission à destination d’un autre Etat de l’Union européenne, pour examen de sa demande d’asile en application du règlement dit « Dublin II ».
Dès lors que le 4. de l’article 19 du règlement n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (dans un cas de prise en charge et de l’article 20 du règlement dans un cas de reprise en charge), prévoyait l’exécution du transfert vers l’autre Etat de l’Union européenne dans un délai de six mois, sous réserve de transfert de la responsabilité de l’examen de la demande d’asile à l’Etat auprès duquel cette demande a été introduite, le tribunal administratif a estimé que les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse l’admission au séjour d’un demandeur d’asile et prévoit le transfert du demandeur vers un Etat membre responsable, non exécutées, cessaient de plein droit d’être applicables à l’expiration d’un délai de six mois (dix-huit en cas de fuite). En conséquence, le tribunal administratif a estimé que cette décision devenait caduque six mois (ou dix-huit mois) après l’accord de l’Etat membre requis, et que dès lors les conclusions tendant à l’annulation de cette décision avaient perdu leur objet. Le tribunal administratif, après avoir vérifié l’inexécution de la décision pendant un délai de six mois, a prononcé un non-lieu à statuer.
Remarque : la même solution a été adoptée dans d’autres jugements du même jour pour l’application du règlement Dublin III (règlement C.E. n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013).
. Tribunal administratif de Limoges, 2 juillet 2015, Mme A…C.… n°1401374, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Comme dans l’affaire n°1300764, le tribunal administratif était saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le préfet, saisi d’une demande d’un étranger tendant au bénéfice du statut de réfugié, après que lui a été refusée la qualité de demandeur d’asile, prononce sa réadmission à destination d’un autre Etat de l’Union européenne, pour examen de sa demande d’asile en application du règlement dit « Dublin III ».
Si le tribunal administratif a estimé, dans les affaires du même jour, que la décision par laquelle l’autorité administrative refuse l’admission au séjour d’un demandeur d’asile et prévoit le transfert du demandeur vers un Etat membre responsable, non exécutée, cessait de plein droit d’être applicable à l’expiration d’un délai de six mois (dix-huit en cas de fuite), le Tribunal a – implicitement puisqu’il n’a prononcé aucun non-lieu à statuer – estimé que la suspension de la décision portant transfert du demandeur d’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne par le juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avait pour effet de suspendre le délai de six mois prévu par les dispositions du règlement « Dublin III » pour l’exécution du transfert. Dès lors, la décision prononçant le transfert du demandeur d’asile dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour examen de sa demande n’est pas devenue caduque.
Fonctionnaires et agents publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 18 juin 2015, M. C… A….., n°1401930, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif était saisi de la contestation par un fonctionnaire, de la décision par laquelle l’autorité administrative avait prononcé sa radiation des cadres, dès lors qu’un jugement du Tribunal correctionnel avait prononcé, à l’encontre de ce fonctionnaire, une peine complémentaire d’interdiction d’exercer son activité professionnelle, laquelle lui avait permis la commission de l’infraction. Cette peine complémentaire n’avait pas été confirmée par la cour d’appel.
Si la jurisprudence estime que la radiation des cadres, en application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983, ne peut intervenir que lorsque la condamnation pénale a acquis un caractère définitif, l’application des dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale, permettant au juge pénal de déclarer les sanctions pénales exécutoires par provision constitue une exception à ce principe et permet à l’autorité administrative de prononcer la radiation des cadres du fonctionnaire alors même que la condamnation à l’interdiction d’exercer son activité professionnelle n’a pas acquis un caractère définitif. Le tribunal administratif a appliqué ici, au cas d’un fonctionnaire, les principes dégagés par le Conseil d'Etat dans le cas de la démission d’office d’un conseiller municipal prononcée par le préfet (Conseil d'Etat, 20 juin 2012, n°356865, aux tables du recueil).
. Tribunal administratif de Limoges, 21 mai 2015, Syndicat CGT du centre hospitalier de Châteauroux, n°13783.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif a été saisi de la requête d’un syndicat de fonctionnaires tendant à l’annulation d’une décision du centre hospitalier refusant d’attribuer aux agents du service de pédiatrie-néonatalogie la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions du décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière.
En l’espèce, le directeur du centre hospitalier avait fondé son refus sur la circonstance que les agents n’étaient pas exclusivement affectés en service de néonatalogie. Cette condition résultait des dispositions d’une circulaire du 22 juillet 2007 (n°DH/FH 1/DAS/T.S 3 n°97-518 du 22 juillet 1997) précisant que les dispositions du décret du 5 février 1997 visaient, en réalité, l’activité des services spécialisés qui ne prodiguent des soins qu’à des nouveaux-nés présentant des pathologies aiguës, des détresses graves ou des risques vitaux et que la bonification ne pouvait pas être versée aux agents des autres services pédiatriques qui, bien que disposant d'unités accueillant des nouveau-nés, n'ont pas pour vocation de soigner ces seuls enfants. Cette circulaire, émanant du ministre de l’emploi, publiée sur le site internet dédié circulaires.gouv.fr (décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008) et sa légalité ayant été reconnue par la juridiction administrative (Conseil d'Etat, 20 janvier 1999, n°190774, inédite), le Tribunal a estimé que cette circulaire pouvait légalement justifier la décision du directeur du centre hospitalier. Le tribunal administratif a donc rejeté la requête du syndicat.
. Tribunal administratif de Limoges, 21 mai 2015, M. A.. B…. n°1301563.
Président-rapporteur : M. Iselin.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif a été saisi de la requête d’un ancien fonctionnaire, s’étant vu concédé une pension civile de retraite, dont l’administration avait suspendu le bénéfice, en estimant que l’intéressé avait perçu, en 2012, une rémunération d’activité trop importante eu égard aux règles de cumul entre pension de retraite et salaire, résultant des dispositions des articles L. 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le tribunal administratif a cependant constaté que les salaires versés au requérant en janvier 2012 correspondaient en réalité à des sommes dues au titre de vacations effectuées au cours des mois de novembre et décembre 2011. Ces sommes devaient donc, pour l’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, être rattachées à la rémunération annuelle due au titre de l’année 2011 et non à celle de l’année 2012 (Conseil d'Etat, 15 novembre 2006, n°275808, aux tables du recueil).
Le tribunal administratif a donc annulé la décision du directeur du service des pensions suspendant le paiement de la pension de retraite de l’intéressé.
. Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2015, Mme B… C… , n°1300511.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le tribunal administratif a été saisi de la légalité du refus, opposé par le ministre à un secrétaire administratif, de concourir aux épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’attaché d’administration. Le décret n°2007-537 du 10 avril 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prévoyant l’accès à ce corps, par voie d’examen professionnel, pour les secrétaires administratif ayant une certaine ancienneté, le ministre avait estimé que les services accomplis par le fonctionnaire en qualité de contractuelle du ministère ne pouvaient être pris en compte.
Le tribunal administratif a annulé pour erreur de droit cette décision, dès lors qu’en l’absence de disposition contraire, pour apprécier une durée minimale de services accomplis dans un emploi donné, ces services devaient être regardés comme incluant ceux accomplis en qualité de non titulaire (Conseil d'Etat du 23 décembre 2010, Centre national de la fonction publique territoriale, n°325144, aux tables du recueil).
Procédure.
. Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2015, Mme C… B… , n°1300250.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Une fonctionnaire hospitalière avait contesté le refus du directeur du centre hospitalier de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle avait développée. L’administration ayant, postérieurement à la saisine du Tribunal, pris une décision reconnaissant cette imputabilité, le Tribunal avait prononcé un non-lieu à statuer.
Postérieurement, l’intéressée n’avait pu obtenir le versement du plein traitement dont les dispositions de l’article de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière lui permettaient de bénéficier en raison de l’imputabilité au service de la pathologie, elle a saisi le tribunal administratif d’une requête à fin d’exécution fondée sur les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Néanmoins, le tribunal administratif a rappelé que le jugement de non-lieu à statuer intervenu dans le contentieux de l’annulation s’était abstenu d’examiner les conclusions présentées et s’était borné à constater la disparition du litige. Dès lors, le jugement de non-lieu à statuer antérieur n’est ni créateur de droits, ni susceptible de mesures d’exécutions (Conseil d'Etat, 9 janvier 1959, Dame Boigé, n°34254 et 34257, recueil p. 31).
Le tribunal administratif a donc rejeté les conclusions de la fonctionnaire à fin d’exécution du jugement de non-lieu à statuer.
Travail et emploi.
. Tribunal administratif de Limoges, 13 mai 2015, Société E., n° 1401505
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal était saisi d’un recours en annulation contre une décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social avait refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé.
Pour justifier la décision litigieuse, le ministre du travail reprochait notamment à la société requérante de ne pas avoir satisfait à l’obligation de reclassement à laquelle elle est tenue en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
Le tribunal a estimé, au regard des pièces du dossier, que la société requérante avait rempli avec sérieux et loyauté l’obligation de reclassement qui lui incombait dès lors que le salarié protégé, dont le licenciement pour inaptitude était in fine envisagé, avait auparavant bénéficié d’un bilan de compétences et s’était vu proposer, après consultation des organismes adéquats, plusieurs postes compatibles avec son état de santé tant dans les établissements que possède la société requérante que dans ceux du groupe auquel cette société appartient.
La juridiction en a déduit que le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social avait commis une erreur d’appréciation en prenant la décision litigieuse et elle a donc annulé cette décision.
. Tribunal administratif de Limoges, 25 juin 2015, Société B., n° 1300095
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : M. Debrion.
Une société spécialisée dans la fabrication de composants électromécaniques et électrohydrauliques pour l’industrie automobile souhaitait, dans son règlement intérieur, interdire de manière générale et absolue à ses salariés de fumer sur l’intégralité de son site.
L’inspecteur du travail et le directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Limousin lui ont toutefois demandé, par deux décisions distinctes, de retirer une telle clause de son règlement intérieur.
La société en question a donc saisi le tribunal afin de demander l’annulation des deux décisions précitées.
Le tribunal a considéré qu’une telle mesure d’interdiction envisagée par la société requérante portait atteinte aux libertés individuelles des salariés et n’était justifiée ni par la nature des tâches à accomplir dans l’entreprise ni proportionnée aux buts recherchés à savoir lutter contre les risques de pollution des produits, optimiser la qualité et l’organisation du travail ou encore promouvoir le concept d’ « une entreprise sans tabac ».
Par suite, la requête a été rejetée.
. Tribunal administratif de Limoges, 25 juin 2015, Société T., n° 1300521
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal était saisi d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à verser à une société une somme d’argent en réparation des préjudices subis eu égard notamment aux manquements commis dans le traitement de sa demande d’autorisation de licenciement d’une de ses employées ayant la qualité de salarié protégé.
Pour statuer sur cette demande, la juridiction a dû notamment se prononcer au préalable sur la légalité d’une décision par laquelle l’inspecteur du travail avait refusé d’autoriser le licenciement de cette salariée protégée en raison d’une irrégularité de procédure résultant de ce que l’entretien préalable de cette salariée avait eu lieu sous forme d’une visioconférence.
Le tribunal a estimé qu’il était possible de recourir légalement à la visioconférence pour mener l’entretien préalable à un licenciement prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail dès lors qu’un tel mode d’entretien avait été accepté par la salariée protégée et qu’il ne faisait obstacle ni à ce que l’employeur indique les motifs du licenciement envisagé et recueille les explications de la salariée ni à ce qu’un dialogue s’engage entre l’employeur et la salariée.
Par suite, il a considéré que la décision prise par l’inspecteur du travail était illégale et que cette illégalité était constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Le tribunal ne s’est toutefois pas prononcé dans son jugement sur les préjudices subis par la société en raison de l’insuffisance des éléments présents au dossier et a ordonné un supplément d’instruction afin d’obtenir tous éléments qui lui permettront, ultérieurement, de statuer définitivement sur le recours indemnitaire dont il a été saisi.
Travaux publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 16 juillet 2015, Mme L … et Mme G …, n° 1300961
Président- rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal administratif était saisi d’une demande indemnitaire par des propriétaires riveraines d’une voie départementale située en surplomb, qui se plaignaient des conséquences de l’effondrement du mur séparant leur propriété de la voie. Un désaccord opposait les parties quant à la propriété du mur.
Le tribunal a estimé qu’en l’absence de tout titre de propriété permettant d’attribuer la propriété du mur aux requérantes ou à des tiers, le mur, qui était un mur de soutènement de la voie, devait être regardé comme un accessoire de la voie publique et, par suite, comme étant la propriété du département, alors même qu’un acte d’alignement individuel semblait inclure le mur dans la propriété des intéressées.
Le tribunal en a déduit que le département était responsable, même sans faute, des dommages causés à des tiers par l’effondrement du mur dont il avait la garde. La demande indemnitaire a cependant été rejetée faute d’éléments démontrant la réalité du préjudice invoqué.
Jurisprudence du 1er mars 2015 au 30 avril 2015
Collectivités territoriales.
. Tribunal administratif de Limoges, 2 avril 2015, SIVOM de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière, n°1300014.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal devait examiner la légalité de la délibération n°2012-7 du 9 novembre 2012 par laquelle le syndicat mixte « ouvert » « le syndicat mixte d’études pour la gestion des déchets ménagers en Creuse » a rejeté la demande syndicat mixte « fermé » du « SIVOM de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière » tendant à son retrait du syndicat mixte d’études.
Pour ce faire, le tribunal a notamment dû se prononcer sur la conformité de l’article 6 des statuts du syndicat mixte d’études (SME) à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales.
L’article 6 des statuts du SME prévoyait que le retrait du syndicat d’un de ses membres était subordonné à l’approbation, d’une part, du comité syndical statuant à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés et, d’autre part, aux deux tiers au moins des assemblées délibérantes des membres du syndicat. Le tribunal a estimé qu’un tel mécanisme de retrait répondait aux buts, d’intérêt général, que constituent la nécessité de ne pas compromettre le fonctionnement et la stabilité du syndicat ainsi que la cohérence de la coopération locale. Il a par suite considéré que ces buts permettaient d’apporter des limitations à la libre administration du SIVOM de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière et qu’ainsi, le principe de libre administration des collectivités territoriales n’avait pas, en l’espèce, été méconnu.
Après avoir écarté les autres moyens présentés par le SIVOM requérant, le tribunal a rejeté la requête.
. Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2015, M. M…et M. C…, n°1300417.
Président-rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
L’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet de département peut transférer à titre gratuit à la commune les biens d'une section de commune, sur demande du conseil municipal, notamment lorsque depuis plus de trois années consécutives (cinq années dans la version applicable au litige), les impôts relatifs à ces biens ont été payés sur le budget communal. Par une décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a admis la conformité de ces dispositions à la Constitution en relevant que les situations visées traduisaient de la part des ayants droit de la section un désintérêt manifeste pour le fonctionnement de la section et pour la gestion de ses biens et que le législateur avait entendu permettre aux communes de mettre un terme au dysfonctionnement administratif ou financier de la section.
Deux ayants-droit de sections d’une commune de Creuse ont contesté devant le tribunal un arrêté du préfet de la Creuse transférant à la commune les biens de ces sections au motif que la commune acquittait les impôts relatifs à ces biens depuis plus de cinq années. Le tribunal a annulé cet arrêté en estimant que ce transfert à titre gratuit ne pouvait pas légalement intervenir si la commune avait acquitté les impôts de sa propre initiative, sans transmettre les avis d’imposition aux ayants droit concernés et sans que les impositions aient été réclamées à ces ayants droit. Le tribunal a considéré que, dans une telle situation, les ayants droit ne pouvaient pas être considérés comme se désintéressant manifestement de la gestion des biens de la section.
Compétence.
. tribunal administratif de Limoges, 2 avril 2015, M. F…, n°1300376.
Président-rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
A l’occasion d’un litige opposant M. F. à la commune de Soursac, le tribunal a été confronté à une question relative au droit de propriété. Il a estimé que cette question présentait une difficulté sérieuse nécessitant la saisine du juge judiciaire. Il a donc fait application, pour la première fois depuis leur entrée en vigueur le 1er avril 2015, des dispositions prévues à l’article R. 771-2 du code de justice administrative aux termes duquel : «« Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Ces nouvelles dispositions permettent en effet au juge administratif de poser directement une question préjudicielle au juge judiciaire alors, qu’auparavant, il appartenait au requérant de saisir l’autre ordre de juridiction compétent pour examiner la question dont la réponse conditionnait le sort du litige initial.
Droits civils et individuels.
. Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2015, M. B…, n°1300089.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : M. Debrion.
M. B. a demandé au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 11 640 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de pratiquer son culte lorsqu’il était détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux.
Le tribunal rappelle dans son jugement que si la liberté de culte en milieu carcéral s’exerce sous réserve des prérogatives dont dispose l'autorité administrative aux fins de préserver l'ordre et la sécurité au sein des établissements pénitentiaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne conditionne la désignation d'un aumônier à un nombre minimum de détenus susceptibles de recourir à son assistance spirituelle. Il en déduit que l’Etat a commis une faute en refusant à M. B., se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah, une assistance spirituelle telle qu’elle est prévue à l’article D. 432 du code de procédure pénale alors applicable au motif que le nombre de détenus se revendiquant de la confession précitée était insuffisant.
Le tribunal considère également que l’Etat a commis une faute en privant M. B. de son droit à des offices religieux se déroulant dans un local adapté à cet effet alors qu’il n’est pas démontré que de tels offices ne pouvaient avoir lieu pour des raisons matérielles, organisationnelles ou de sécurité.
Enfin, le tribunal estime que l’Etat ne pouvait, sans commettre de faute, refuser à M. B. l’accès aux revues religieuses conformément à l’article D. 444 du code de procédure pénale alors applicable dès lors qu’il n’est pas invoqué que lesdites revues contenaient des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.
Compte tenu des fautes retenues, le tribunal accorde à M. B. une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Fonctionnaires et agents publics.
. tribunal administratif de Limoges, 12 mars 2015, Mme D…, n°1201575.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal administratif était saisi par un fonctionnaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie contestant le coefficient de la part fonctionnelle de prime de fonctions et de résultats qui lui avait été attribué pour l’année 2011, prime résultant, pour les fonctionnaires de ce ministère, du décret du 22 décembre 2008 et d’un arrêté du 26 octobre 2010.
Il était constant que la fixation de ce coefficient résultait d’une méthode instaurée par une note de gestion du 19 juillet 2011 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les corps de catégorie B du MEDDTL, cette note ayant pour but d’appliquer, aux fonctionnaires de ces corps, le principe, défini par une circulaire du 14 avril 2009, de maintien individuel des montants indemnitaires lors de la mise en place de la nouvelle prime de fonctions et de résultats.
Le Tribunal a néanmoins constaté que si cette note du 19 juillet 2011 avait été publiée au bulletin officiel, elle n’avait fait l’objet d’aucune publication sur le site internet Légifrance. Il a donc estimé que cette note n’était donc pas, en application des dispositions du décret du 22 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, juridiquement opposable. Il a en déduit que la décision, prise sur le fondement d’un texte inapplicable, est illégale et devait être annulée, après avoir soulevé ce moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
. tribunal administratif de Limoges, 12 mars 2015, M. P…, n°1301040.
Président-rapporteur : M. Iselin.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal administratif était saisi de la requête d’un militaire de carrière qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1997 et qui, postérieurement à cette admission, avait effectué des services dans la réserve opérationnelle. Ce militaire contestait le refus du ministre de la défense de réviser sa pension militaire de retraite pour tenir compte des services effectués dans la réserve opérationnelle.
Le Tribunal a cependant estimé qu’il résultait des dispositions de l’article 5 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires que seule devait être prise en compte l’ancienneté acquise dans le grade au moment de la radiation des cadres du militaire, et que dès lors les services effectués en qualité d’officier réserviste, qui avaient été effectués postérieurement à la date de radiation des cadres du militaire, ne pouvaient être pris en compte.
Le Tribunal a donc rejeté la requête présentée devant lui.
. tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2015, M. L…, n°1500025 et 1401692.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi, notamment, de la requête d’un agent contractuel de l’Université de Limoges qui contestait le refus de la présidente de l’université de transformer son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions combinées de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, et de l’article 37 de cette même loi, prévoyant que lorsqu’un agent atteint une ancienneté de six mois avant l’échéance de son contrat en cours, le contrat conclu est réputé être conclu à durée indéterminée.
En l’espèce, l’agent avait exercé des fonctions de chercheur post-doctorant auprès du laboratoire photonique d’un institut situé dans les locaux de l’université entre octobre 2007 et octobre 2014. Néanmoins, il avait, au cours de cette période, conclu des contrats, à durée déterminée, alternativement avec l’université de Limoges et avec l’agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin (AVRUL).
Faisant néanmoins application des principes jurisprudentiels dégagés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2013 (n°1208556, 1208668 et 1211336), le tribunal administratif de Limoges a estimé, après avoir analysé les conditions concrètes d’exercice de ses fonctions par le requérant et les relations entre l’Université de Limoges et l’AVRUL, que l’agence devait être regardée comme agissant pour le compte de l’université qui apparaissait, en conséquence, comme l’unique et véritable employeur du requérant. Le Tribunal a donc considéré que l’ensemble des services effectués par l’intéressé entre octobre 2007 et octobre 2014 devaient être regardés comme ayant été effectués auprès du même établissement public, malgré le statut de droit privé de l’AVRUL.
Dès lors le tribunal administratif a estimé que le dernier contrat du requérant devait être requalifié en engagement à durée indéterminée et a annulé la décision contestée pour méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984.
Travail et emploi.
. Tribunal administratif de Limoges, 30 mars 2015, Syndicat Chimie Energie Auvergne Limousin CFDT, n°1500013.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal a été amené à se prononcer, pour la première fois depuis la réforme introduite par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, dans un litige relatif à un projet de licenciement économique collectif, et plus spécifiquement s’agissant du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) y afférent.
La société Catalent est une société spécialisée dans la production de seringues stériles pré-remplies (« seringues ») et de remplissage de poches parentérales stériles (« poches »). La réorganisation de son activité autour de l’activité « seringues » l’a conduit à envisager des licenciements pour motif économique et, en conséquent, à conclure, avec les syndicats représentatifs au sein de la société, un accord collectif majoritaire sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. Cet accord, qui a recueilli 100% des suffrages exprimés par les organisations syndicales reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, a été signé fin octobre 2014. Le 6 novembre suivant, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du Limousin a validé l’accord précité.
C’est cette décision prise par la Direccte du Limousin qui a été contestée devant le tribunal par le Syndicat chimie énergie Auvergne Limousin CFDT, non signataire de l’accord collectif majoritaire précité.
Plusieurs moyens, tant de légalité externe que de légalité interne, étaient soulevés à l’encontre de la décision portant validation du PSE.
Après examen des différents moyens, le tribunal a estimé qu’aucun d’entre eux n’était de nature à fonder l’annulation de la décision contestée et a donc rejeté le recours présenté par le Syndicat chimie énergie Auvergne Limousin CFDT.
Urbanisme.
. Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2015, Mme B…, n°1201542.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal était saisi, par Mme B., d’une demande d’annulation d’un permis de construire, qui avait été accordé en juin 2012 à M. E., pour la construction de deux pavillons et d’un garage sur le territoire de la commune de Châteauroux. Ce permis avait vocation à régulariser les constructions précitées, qui avaient initialement été autorisées par un permis de construire délivré au cours de l’année 2009 et que la juridiction administrative limougeaude avait annulé en septembre 2011.
Le tribunal a considéré que ce nouveau permis de construire était illégal dès lors que la hauteur au faîtage de l’une des deux maisons était supérieure à la hauteur maximale prévue par les dispositions de l’article Up 7.2 du plan local d’urbanisme de la commune.
Néanmoins, il a estimé que l’illégalité constatée n’affectait qu’une partie identifiable du projet et qu’il était possible de remédier à cette illégalité, sans affecter l’économie générale du projet, par la délivrance d’un permis modificatif. Il n’a, en conséquence, prononcé qu’une annulation partielle du permis de construire comme l’y autorise l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en pareille hypothèse.
Voirie.
. Tribunal administratif de Limoges, 5 mars 2015, Mme de F…, n°1300021 et 1400385.
Président-rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal était saisi d’un recours en annulation contre une décision par laquelle le maire d’une commune avait implicitement refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal une question relative aux travaux d’élargissement d’un chemin rural ouvert à la circulation publique.
Le tribunal a considéré, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, qu’il appartenait au maire de se prononcer sur la demande d’inscription de cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal et que le maire n’aurait été tenu de saisir le conseil municipal que si la question avait été posée par le représentant de l’Etat, par une majorité de membres du conseil municipal ou par une majorité de propriétaires riverains du chemin, dans les conditions prévues aux articles L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales ou L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime.
Sur le fond, le tribunal a rappelé que les communes n'étaient en principe tenues ni d'améliorer ni d’élargir les chemins ruraux, ni d’engager des travaux permettant l’usage d’un chemin rural par des véhicules de grande largeur. Dans l’affaire qui était soumise au tribunal, le chemin, d’une longueur de 150 mètres, desservant cinq habitations, présentait une largeur de 2,50 mètres environ dans sa partie la plus étroite. Le tribunal a estimé que cette configuration ne faisait pas obstacle à la sécurité des propriétés desservies. La commune produisait au dossier une attestation du directeur du service départemental d’incendie et de secours selon laquelle l’accès des secours ne posait pas de difficulté.
La requête a donc été rejetée.
Jurisprudence du 1er janvier 2015 au 28 février 2015
Etrangers.
.Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2015, M. A… contre préfet de la Haute-Vienne, n°141970, C.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Houssais.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi d’une requête, dirigée contre un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, émanant d’un ressortissant guinéen qui invoquait, notamment, le fait que sa fille, née en France, s’était vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison de risques d’excision dans son pays d’origine.
Les exigences résultant du droit à mener une vie privée et familiale normale, résultant notamment de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impliquent que les parents d’une réfugiée mineure, si cette circonstance n’implique qu’ils se voient également reconnaître le statut de réfugié, puissent en principe séjourner régulièrement en France avec leur fille (avis contentieux du Conseil d'Etat du 20 décembre 2013, n°368676, au recueil).
Le Tribunal a, néanmoins, estimé que le parent d’une réfugiée mineure qui invoque, notamment, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant doit justifier de liens avec sa fille réfugiée et notamment participer à son entretien et son éducation. En l’espèce, le Tribunal a considéré que le requérant, vivant éloigné de sa fille reconnue réfugiée, n’établissait participer à son entretien et son éducation. Il a donc rejeté les conclusions dirigées contre le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui avaient été opposés.
.Tribunal administratif de Limoges, 23 février 2015, M. et Mme A… contre préfet de la Haute-Vienne, n°15345 et n°15346.
Magistrat désigné : M. Debrion.
Le Tribunal était saisi de requêtes dirigées contre des décisions portant remise de demandeurs d’asile aux autorités croates pour examen de la demande d’asile, et assignation à résidence.
Le Tribunal a fait application de l’article 14 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, cet article prévoyant le cas des demandeurs d’asile exemptés de l’obligation de visa pour entrer dans le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. Le Tribunal a ainsi considéré que lorsque le ressortissant d’un pays tiers entre sur le territoire de plusieurs Etats membres, dans lesquels il est exempté de l’obligation de visa, l’Etat membre compétent pour examiner la demande de protection internationale formulée est le premier Etat à avoir été destinataire de la demande.
En l’espèce, quand bien même les requérants, de nationalité albanaise, avaient séjourné, avant d’entrer en France, en Croatie, ils n’avaient déposé de demande d’asile qu’en France, pays à l’entrée duquel ils étaient exemptés de l’obligation de visa dès lors qu’il n’était pas contesté qu’ils étaient titulaires de passeports biométriques. Dès lors, le Tribunal a considéré qu’en estimant que la Croatie, pays dans lequel il n’était pas établi que les requérants aient déposé des demandes d’asile, était responsable de l’examen de ces demandes, le préfet avait méconnu le 2. de l’article 14 du règlement UE du 26 juin 2013.
Fonctionnaires et agents publics.
.Tribunal administratif de Limoges, 12 février 2015, M. A…contre centre hospitalier d’Aubusson., n°121038, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Houssais.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi d’une requête émanant d’un médecin bulgare, recruté comme assistant spécialiste associé puis comme praticien hospitalier contractuel par le centre hospitalier d’Aubusson, contre un titre exécutoire émanant de ce centre hospitalier.
Le requérant avait été recruté par le centre hospitalier par l’intermédiaire de l’Association pour la recherche et l’installation de médecins européens. Avant le début de ses fonctions, il avait signé un engagement de servir le centre hospitalier pour une durée de cinq années et s’était engagé, en cas de non respect de cette période, à verser, à proportion de la durée restante, une somme équivalente au montant versé par le centre hospitalier à l’Association pour la recherche et l’installation de médecins européens. Le requérant ayant souhaité quitter le centre hospitalier avant la fin de la période d’engagement de cinq ans, le centre hospitalier avait émis, à son encontre, un titre exécutoire.
Le Tribunal a considéré qu’eu égard à la situation légale et réglementaire des praticiens hospitaliers contractuels, qui sont soumis aux dispositions du code de la santé publique, lequel régit, pour les personnels médicaux, les conditions de leur recrutement, celles de leurs nomination et leur rémunération, le centre hospitalier ne pouvait légalement faire signer au requérant un contrat d’engagement de servir. Le Tribunal a, en conséquence, estimé que le centre hospitalier avait commis une faute en faisant signer ce contrat et que celui-ci ne pouvait fonder le titre exécutoire contesté.
Marchés et contrats administratifs.
. tribunal administratif de Limoges, 15 janvier 2015, Société G2C Environnement contre commune de Tulle, n°121752, C+
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi d’une requête émanant d’une société dont la candidature à un marché public portant sur la réalisation, pour la commune de Tulle, d’audits sur la gestion déléguée de plusieurs services publics, avait été rejetée. La société évincée demandait l’annulation du marché conclu par la commune de Tulle.
Le Tribunal a estimé qu’au cours de la procédure de passation des lots du marché, la commune avait commis un manquement aux obligations de mise en concurrence en décidant, dans l’avis d’appel public à la concurrence, de limiter à cinq le nombre de candidats admis à présenter une offre, sans fournir aux entreprises candidates une information sur les critères de sélection de ces candidatures appropriée à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché.
Le Tribunal a ainsi appliqué, au contentieux de l’annulation des marchés, les principes dégagés par la décision du Conseil d'Etat du 24 février 2010, Communauté de communes de l’Enclave des Papes (n°333569, au recueil), dans le cadre du référé prévu par l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Le Tribunal a, en effet, appliquant les principes de la décision d’Assemblée du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation (n°291545, au recueil) estimé que l’illégalité commise avait affecté la validité même du choix de l’attributaire du marché et constituait un vice suffisamment grave pour justifier l’annulation du marché, cette annulation ne portant pas, y compris du fait de sa nature rétroactive, une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des co-contractants.
Le Tribunal a donc annulé les trois lots du marché conclus par la commune de Tulle pour la réalisation d’audits sur la gestion déléguée de plusieurs services publics.
Procédure.
.Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2015, Mme A…. contre Communauté d'agglomération castelroussine et autre,n°121727 et 13123, C+
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi d’une requête dirigée contre un arrêté portant, d’une part, déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux et l’établissement de périmètres de protection de puits alimentant la Communauté d'agglomération castelroussine en eau potable, et d’autre part, autorisant les ouvrages nécessaires à la dérivation et l’utilisation de l’eau à des fins de consommation humaine.
Le Tribunal a estimé que, même si le délai de recours contentieux contre un arrêté portant déclaration d'utilité publique commençait à courir à compter de la publication de cet arrêté, et que ne s’appliquaient pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative subordonnant l’opposabilité du recours contentieux à sa mention dans une notification, la circonstance que l’arrêté portant déclaration d'utilité publique comporte, dans ses articles, la mention de voies et délais de recours erronés permet aux personnes intéressées de bénéficier du délai de recours mentionné à tort par l’arrêté.
En l’espèce, alors que le recours contentieux contre un arrêté portant déclaration d'utilité publique est de deux mois à compter de sa publication, l’arrêté contesté du préfet de l'Indre indiquait qu’il pouvait être contesté dans un délai de deux mois pour les « pétitionnaires » et dans un délai de quatre ans pour les tiers. L’arrêté ne mentionnait aucunement les propriétaires intéressés. Dans ces conditions, le Tribunal a estimé que la requérante, bien qu’ayant introduit sa requête presque quatre ans après la publication de l’arrêté, n’était pas forclose.
Au fond, le Tribunal a fait droit à la requête en estimant qu’aurait dû figurer au dossier soumis à enquête publique une étude d’impact dès lors que le montant des travaux prévisibles était supérieur à 1 900 000 euros. Le Tribunal a, enfin, estimé que compte tenu de l’intérêt général manifeste s’attachant au maintien du fonctionnement des prises d’eau et de leur protection contre la pollution et du moyen d’annulation retenu, l’annulation rétroactive de l’arrêté portant déclaration d'utilité publique porterait une atteinte manifestement excessive au bon fonctionnement et à la continuité du service public de l’alimentation en eau dans plusieurs communes de l’Indre (Conseil d'Etat, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC !, n°255886 et autres, au recueil). En conséquence, le Tribunal a repoussé les effets de son annulation au 1er septembre 2016.
Jurisprudence du 1er novembre au 31 décembre 2014.
Agriculture.
. Tribunal administratif de Limoges, 13 novembre 2014, M. X… contre préfet de la Creuse, n°1400026.
Président-rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal était appelé à se prononcer dans une affaire dans laquelle un agriculteur demandait à être indemnisé de son préjudice lié au refus de l’Etat de lui verser une aide à l’engraissement des jeunes bovins au titre de la campagne 2012.
En premier lieu, la juridiction a estimé que le requérant ne pouvait obtenir la condamnation de l’Etat en invoquant le principe de confiance légitime consacré par le droit communautaire dès lors que le dispositif d’aide à l’engraissement de jeunes bovins auquel il croyait pouvoir prétendre n’avait pas été instauré de manière régulière.
En second lieu, le tribunal a considéré que l’Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’illégalité de la circulaire ministérielle instaurant l’aide précitée. En effet, le ministre chargé de l’agriculture n’était pas compétent pour décider de l’instauration de l’aide à l’engraissement de jeunes bovins et des conditions mises à son attribution. Toutefois, faute pour le requérant d’apporter des précisions quant à la nature et l’étendue du préjudice qu’aurait entraîné pour lui l’annonce illégale de l’attribution d’une aide qui ne lui a pas été versée, et en l’absence d’éléments permettant d’estimer que le requérant aurait adopté un comportement économique, en particulier en exposant des coûts, en fonction de cette annonce, le tribunal en a déduit que l’agriculteur ne justifiait pas l’existence d’un préjudice directement imputable aux engagements illégaux pris par l’Etat et n’a pu, par suite, que rejeter ses prétentions indemnitaires.
Domaine public.
. Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, Ministre de la Défense, n°1400996.
Président-rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
Le tribunal était saisi d’une requête peu habituelle par laquelle le ministre de la défense lui demandait d’ordonner l’expulsion d’un sous-officier de gendarmerie du logement qu’il occupait au sein de la caserne de gendarmerie du Blanc dans l’Indre.
Le tribunal a tout d’abord rappelé le principe selon lequel un militaire placé en congé de longue maladie, qui n’est pas en activité de service au sens de l’article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut occuper effectivement l’emploi qui justifie une concession de logement aux termes de l’article R. 2124-73 du même code, est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Il a ensuite estimé, dans les circonstances de l’espèce, que le sous-officier de gendarmerie concerné, qui était placé en congé de longue maladie depuis le 29 avril 2011 et n’avait pas demandé le bénéfice d’un sursis d’évacuation du logement qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service, pouvait, en l’absence de réponses aux mises en demeure d’évacuer le logement que lui avait adressées l’administration, être expulsé du logement, dépendance du domaine public qu’il occupait désormais sans droit ni titre au sein de la caserne de gendarmerie du Blanc, sans qu’il soit nécessaire d’autoriser spécifiquement le ministre à exécuter le jugement avec le concours de la force publique.
Etrangers.
. Tribunal administratif de Limoges, 20 novembre 2014, M. B. n°1325.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Lorsqu’un étranger remplit, en raison de son état de santé et de l’état des soins existant dans son pays d’origine, toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne peut refuser de lui délivrer ce titre de séjour en considérant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public sans consulter, auparavant, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Faisant application de ces principes rappelés par le Conseil d'Etat (10 août 2005, Préfet de la Seine-Maritime, n°258044, au recueil), le Tribunal administratif a considéré qu’en ne saisissant pas la commission du titre de séjour du cas de M. B…, dont l’état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’il n’existait pas de traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet avait privé l’intéressé d’une garantie. Le Tribunal a donc annulé le refus de séjour opposé à M. B…
. Tribunal administratif de Limoges, 18 décembre 2014, Mme A., n°141641, C+
Président-rapporteur : M. Iselin.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi d’un refus opposé, après l’intervention de l’ordonnance n°2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer une carte de séjour temporaire à une ressortissante comorienne ayant résidé et bénéficié d’un titre de séjour à Mayotte.
Le Tribunal a, tout d’abord, considéré que la carte de séjour dont l’intéressée avait bénéficié dans ce département d’outre-mer ne la dispensait de l’obligation de solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour séjourner en France métropolitaine, dès lors que la carte de séjour dont elle bénéficiait à Mayotte ne figurait pas dans l’article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le Tribunal a, ensuite, considéré que l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui modifie l’article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et inclut Mayotte dans l’acception de l’expression « en France » au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n’avait pas pour effet de faire regarder rétroactivement comme séjournant en France au sens des dispositions de l’article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les enfants français de l’intéressée qui avaient séjourné à Mayotte avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2014-464 du 7 mai 2014.
Le Tribunal a, enfin, considéré que la circonstance que les enfants français de l’intéressée sont entrés en France métropolitaine en accompagnant leur parent ressortissant étranger faisait obstacle à ce qu’ils puissent être regardés comme y résidant au sens du 6° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fonctionnaires et agents publics.
. Tribunal administratif de Limoges, 6 novembre 2014, Syndicat CGT Agence de services et de paiement, n°1200580.
Tribunal administratif de Limoges, 6 novembre 2014, Syndicat CGT Agence de services et de paiement, n°1200583.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Houssais.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal était saisi, par une organisation syndicale, de recours tendant à l’annulation de décisions du directeur général de l’Agence de services et de paiement, dont le siège est à Limoges, relatives à la prime de fonctions et de résultats de certains agents de l’établissement public, qui anciennement agents, notamment, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), avaient été intégrés dans des corps de fonctionnaires du ministère chargé de l’agriculture et avaient bénéficié d’un maintien de leur rémunération en application du chapitre II du décret n°2010-1246 du 20 octobre 2010.
Le Tribunal a, d’une part, analysé l’ancien régime de primes versées à ces agents, et notamment la prime informatique, et estimé que cette ancienne prime avait un objet proche de la partie F (fonctions) de la prime de fonctions et de résultats et que cette partie F de la nouvelle prime pouvait être ventilée en contrepartie de l’ancienne prime informatique au sein du mécanisme de garantie de rémunération instituée par le décret du 20 octobre 2010.
Le Tribunal a, d’autre part, considéré que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la contrariété de la décision du directeur général de l’Agence de services et de paiement avec une note de service du ministre de l’agriculture du 15 septembre 2011, fixant les taux de prime de fonctions et de résultats applicables aux agents du ministère, dès lors que cette note n’avait pas fait l’objet d’une publication sur le site internet www. circulaire.legifrance.gouv.fr.
Police administrative.
. Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, M. B. contre commune de Saint-Martin-de-Jussac, n°1300373.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : M. Debrion.
La juridiction était amenée à se prononcer sur les conditions d’exécution d’un jugement qu’elle avait précédemment rendu.
Ce jugement impliquait, pour la commune de Saint-Martin-de-Jussac, de prendre toute mesure permettant d’assurer la circulation sur la totalité de l’assiette d’un chemin rural et de faire cesser l’ensemble des obstacles à cette circulation en procédant, notamment, à la suppression des clôtures et fils de barbelés ainsi qu’au déblaiement des terres cultivées sur son assiette.
Si, à l’occasion de l’examen de l’affaire en exécution de jugement, il apparaissait que des mesures avaient été prises, le tribunal a estimé que ces dernières n’étaient pas suffisantes pour considérer que le jugement avait parfaitement été exécuté et a donc, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, enjoint, sous astreinte, à la commune de prendre toutes mesures, notamment au titre des pouvoirs de police du maire, en vue d’assurer l’exécution complète de son premier jugement.
Procédure – Expertise.
. Tribunal administratif de Limoges, 30 décembre 2014, Centre hospitalier universitaire de Limoges, n°141375, C+
Président-rapporteur : M. Iselin.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal a rejeté la demande en récusation d’experts déposée par le centre hospitalier universitaire de Limoges, experts qui avaient été désignés dans le cadre d’une instance mettant en cause une patiente, dont les grossesses avaient été médicalement suivies par ce centre hospitalier, et dont les deux enfants été atteints d’embryofoethopathie, probablement imputable à l’administration, au cours de la grossesse de leur mère, de volproate de sodium, commercialisé par le laboratoire Sanofi-Aventis France. Le Tribunal a considéré que la seule circonstance que l’expert désigné en référé ait conclu un pacte civil de solidarité avec une salariée de ce laboratoire n’était pas suffisante pour douter de son impartialité dès lors que contrairement au précédent judiciaire invoqué par le centre hospitalier universitaire, le laboratoire n’était pas partie au litige, qu’aucune indication n’était apportée sur la position de la salariée au sein du laboratoire qui emploi près de 27 000 salariés, et que le litige au principal concernait uniquement le centre hospitalier universitaire de Limoges, dont la responsabilité était recherchée pour avoir prescrit l’administration, sans informer la patiente des risques, d’un médicament dont les effets néfastes en cas de grossesse sont connus depuis de nombreuses années.
Responsabilité de la puissance publique.
. Tribunal administratif de Limoges, 4 décembre 2014, Mme J.D contre centre hospitalier universitaire de Limoges n°111790.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le Tribunal a fait application du régime de responsabilité sans faute des établissements publics de soins, du fait de l’utilisation de produits ou d’appareils de santé défaillants, dégagé par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 9 juillet 2003, Assistance publique-Hôpitaux de Paris (n°220437 au recueil) et du 25 juillet 2013 (n°339922, au recueil).
En l’espèce, à l’issue d’une intervention chirurgicale qui s’était déroulée sans problème, une valve du respirateur de transport équipant le malade entre la salle d’opération et la salle de réveil avait cessé de fonctionner, empêchant le patient d’expirer l’air reçu spontanément, et le système d’alarme du respirateur ne s’était pas déclenché. Le double dysfonctionnement de l’appareil avait entraîné des séquelles neurologiques, puis le décès du patient.
Dès lors que les proches du patient décédé pouvaient, en application du régime de responsabilité sans faute, se tourner uniquement contre l’établissement public de soins, le Tribunal a condamné ce dernier à indemniser les préjudices résultant du décès du patient, aucun appel en garantie n’ayant, au demeurant, été formé contre la société ayant fabriqué le respirateur portatif défectueux.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Jurisprudence du 1er juillet 2014 – 31 octobre 2014
Agriculture, chasse et pêche.
. Tribunal administratif de Limoges, 23 septembre 2014, M. A., n°1201385, C+.
Président-rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
M. A., opposant à la pratique de la chasse et requérant dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 29 avril 1999 reconnaissant l’inconventionnalité de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées dite loi Verdeille, notamment en tant qu’elle ne prévoyait pas un droit d’opposition à la pratique de la chasse, a saisi le tribunal d’une demande en annulation d’un arrêté du 2 août 2012 du préfet de la Creuse en tant qu’il intégrait sa propriété à la réserve de chasse et de faune sauvage de l’association communale de chasse agréée de la Cellette.
Après avoir rappelé la portée des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) qui condamnent un Etat partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal considère qu’un requérant, destinataire d’un tel arrêt, ne peut bénéficier des effets favorables qui lui sont reconnus par ledit arrêt sans avoir au préalable saisi l’administration d’une demande tendant au réexamen de sa situation.
En l’espèce, M. A. n’avait saisi l’administration ni entre la date à laquelle était intervenu l’arrêt de la CEDH de 1999 et celle d’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse consacrant aux opposants éthiques à la chasse la faculté de retirer leur propriété du territoire des associations de chasse agréées quelle que soit la superficie de leurs terrains, ni après l’adoption de la loi précitée de 2000.
Par suite, le tribunal a rejeté la requête en estimant que M. A. n’avait pas régulièrement manifesté son opposition à la pratique de la chasse avant l’intervention de l’arrêté litigieux.
. Tribunal administratif de Limoges, juge des référés, 17 juillet 2014, M. F. contre préfet de la Corrèze,n°1401222, C+.
Vice-président, juge des référés : Mme Jayat.
Saisi d’un recours en référé suspension dirigé contre un arrêté du préfet de la Corrèze prescrivant notamment, dans les deux mois, l’abattage total d’un troupeau de 155 bovins, le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de cette mesure. Le juge estime que la condition d’urgence est remplie, la mesure présentant un caractère irréversible. Selon l’ordonnance, si la lutte contre la tuberculose bovine nécessite de prendre des mesures pour éviter toute contamination d’autres animaux, l’exploitant a fait procéder à des tests sur tout son troupeau et la suspension de la mesure d’abattage total apparaît d’autant plus conciliable avec la lutte contre la maladie, qu’une note du ministère chargé de l’agriculture du 4 juillet 2014 ouvre sur l’ensemble du territoire national la possibilité de déroger à la règle de l’abattage total en cas d’infection par la tuberculose bovine. Enfin, le juge des référés estime que le moyen tiré de ce que l’obligation d’abattage total d’un troupeau en cas d’infection par la tuberculose bovine méconnaît le principe d’égalité devant la loi paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure, des abattages sélectifs étant autorisés par l’administration en Côte d’Or et en Dordogne à la date de l’arrêté contesté.
Ordonnance annulée par le Conseil d'Etat: décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 2014, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n°383483, inédite au recueil. La décision du Conseil d'Etat peut être consultée sur le site internet du Conseil d'Etat (ArianeWeb).
Collectivités territoriales / Enseignement.
. Tribunal administratif de Limoges, 2 octobre 2014, Mme X… contre Région Limousin, n°1201179.
Président-rapporteur : Mme Jayat.
Rapporteur public : M. Debrion.
Des contribuables de la région Limousin avaient saisi le tribunal en vue d’obtenir l’annulation d’un article d’une délibération du conseil régional du Limousin qui prévoyait l’octroi d’une subvention à l’association Calandreta Lemosina en charge de la gestion d’une école primaire privée au sein de laquelle sont assurés la promotion et l’enseignement de la langue occitane.
Le tribunal a décidé d’annuler l’article litigieux en considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’autorisait les collectivités autres que les communes, même en cas de carence de ces dernières, à consentir une aide financière sous quelque forme que ce soit à des écoles primaires privées, et ce, en violation du code de l’éducation qui définit de manière limitative les possibilités d’aide en la matière.
Etrangers.
. Tribunal administratif de Limoges, 23 octobre 2014, Mme B… épouse C… n°1401191, C.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : M. Jourdan.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Lorsqu’il refuse de délivrer à un ressortissant étranger un titre de séjour, le préfet doit vérifier que cette décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, si Mme B…. épouse C…. était entrée en France en 2011 à l’âge de 58 ans, elle accompagnait son fils, titulaire désormais d’un titre de séjour, et atteint d’une pathologie rénale grave, nécessitant, pour une durée indéterminée, la réalisation d’un traitement lourd par hémodialyse. En outre, le fils de Mme B… épouse C…, isolé sur le territoire français à l’exception de sa mère, souffrait d’une grande précarité sociale et d’un isolement familial induisant chez lui des crises suicidaires et des refus de suivre son traitement. Sa mère l’accompagnait dans le suivi de son traitement depuis leur arrivée commune en France. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que le refus de séjour opposé à Mme B…. épouse C…. porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et annule cette décision, ainsi par voie de conséquence que l’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagnait.
Police administrative.
. Tribunal administratif de Limoges, 16 octobre 2014, M. M… contre préfet de la Corrèze, n°1200259, C+.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Girard.
Rapporteur public : M. Debrion.
Après qu’il a été rendu destinataire d’une décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, M. M... a logiquement, en décembre 2010, restitué son titre de conduite aux services préfectoraux de la Corrèze. Toutefois, il a, en avril 2011, obtenu de l’officier du ministère public qu’il abandonne les poursuites consécutives à l’une des infractions qui avaient occasionné pour lui une perte de points sur son permis de conduire. Malgré cette décision de l’officier du ministère public qui impliquait que son titre de conduite soit re-crédité de points par les services du ministère de l’intérieur, M. M. n’a pu récupérer son papier rose qu’en août 2011.
M. M…. a alors saisi le Tribunal administratif afin d’obtenir la condamnation de l’Etat en réparation des préjudices résultant du délai mis par l’administration pour lui restituer son permis de conduire.
Le Tribunal a considéré que dès lors que les services du ministère de l’intérieur avaient été saisis, par l’officier du ministère public, d’une demande de re-créditation de points en mai 2011, et que la situation de l’automobiliste ne présentait pas de complexité particulière, la restitution de son permis de conduire à M. M… aurait dû intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’avertissement des services du ministère. Par suite, le Tribunal a estimé que la restitution de son permis de conduire au requérant en août 2011 était intervenue au terme d’un délai excessif constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Au regard des justificatifs fournis au tribunal, M. M… a pu obtenir réparation des préjudices consécutifs à ce délai jugé excessif.
Professions – charges et offices.
. Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2014, M. S contre ministre de la culture, n°121764, C+.
Président : M. Iselin.
Rapporteur : Mme Ozenne.
Rapporteur public : Mme Béria-Guillaumie.
Le conseil régional de l’ordre des architectes a le pouvoir, en application des articles 10 et 23 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de radier un architecte du tableau de l’ordre si l’intéressé ne remplit plus l’une des conditions légales exigibles pour exercer la profession. Le Tribunal a cependant estimé que le conseil ne peut utiliser cette procédure de radiation que si ceci résulte d’un simple constat objectif d’un état de fait. En revanche, si le conseil régional de l’ordre est amené à porter une appréciation sur ces faits, en estimant que les faits sont de nature, par leur gravité, à faire regarder l’architecte comme ne répondant plus à la condition de moralité exigée pour être inscrit au tableau de l’ordre, la décision de radiation ne peut être adoptée en dehors de la procédure applicable aux sanctions disciplinaires.
En conséquence, le Tribunal a annulé la radiation du tableau de l’ordre de M. S, qui avait eu comportement très menaçant et des gestes violents vis-à-vis notamment d’un maître d’ouvrage, dès lors que cette décision, fondée sur une appréciation du comportement de l’intéressé, entrait dans le champ d’application des sanctions disciplinaires applicables aux architectes.
Urbanisme et aménagement du territoire.
. Tribunal administratif de Limoges, 2 octobre 2014, SAS Solar enviro partners, n°1200805.
Président : Mme Jayat.
Rapporteur : M. Panighel.
Rapporteur public : M. Debrion.
Saisi d’un recours dirigé contre un arrêté du préfet de l’Indre refusant d’accorder à la société Solar enviro partners un permis de construire pour la création d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Prissac, le tribunal a annulé le refus de permis.
Pour ce faire, il a estimé que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme qui prévoit notamment qu’un projet peut être refusé s’il est de nature à compromettre l’activité agricole. En l’espèce, la juridiction a considéré que, compte tenu de ses caractéristiques, le projet envisagé par la société Solar enviro patners était parfaitement compatible avec la poursuite d’une activité agricole, et plus particulièrement celle d’un élevage ovin.
Le tribunal a ensuite enjoint au préfet de réexaminer la demande de permis de construire présentée par la société.